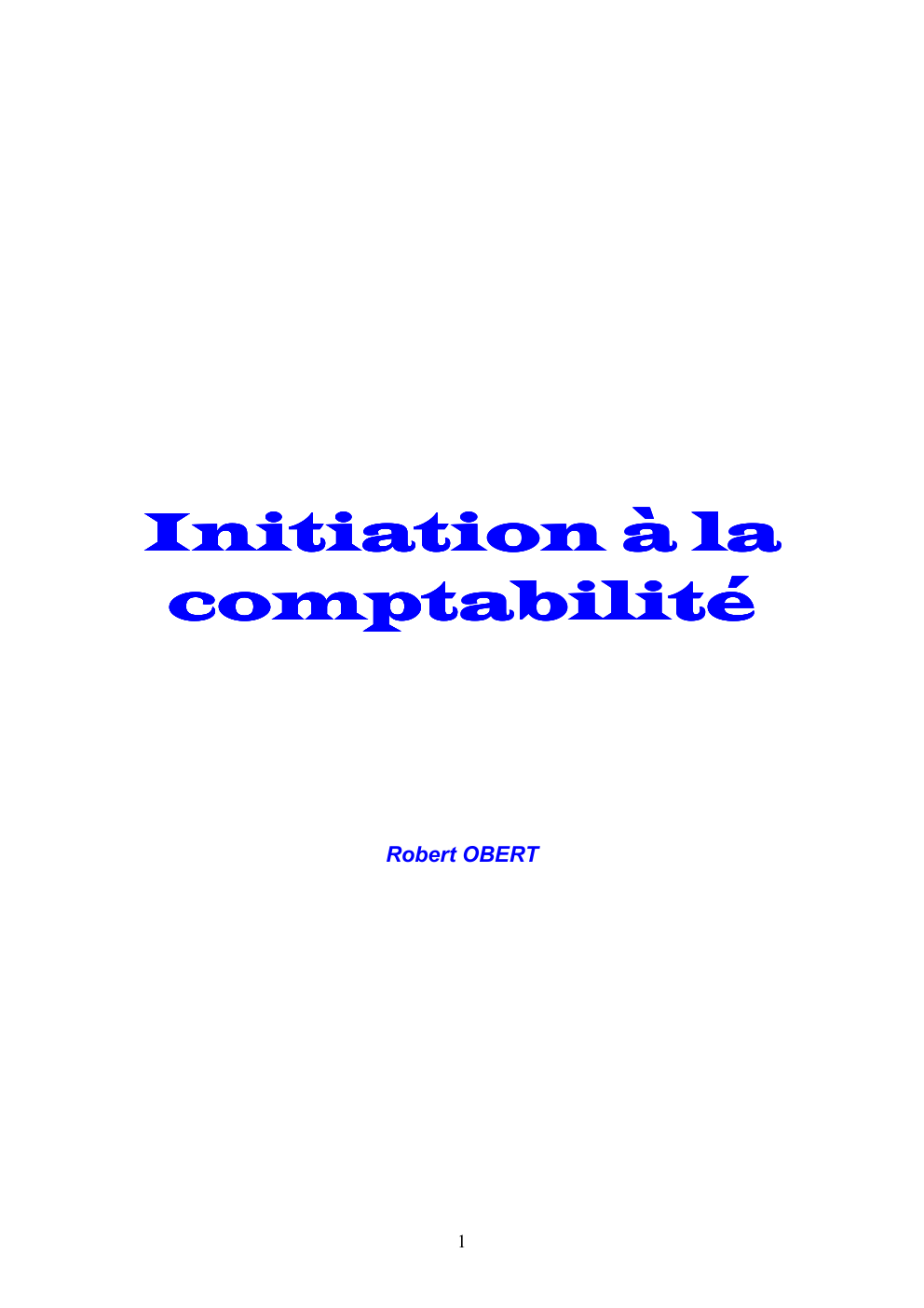Initiation à la comptabilité
Publié le 24/12/2024
Extrait du document
«
Initiation à la
comptabilité
Robert OBERT
1
Sommaire
Fiche 1 : Définition et rôle de la comptabilité
Fiche 2 : Bilan et compte de résultat
Fiche 3 : Les variations d’actif et de passif
Fiche 4 : Les charges et les produits
Fiche 5 : Les variations de stock
Fiche 6 : Les règles d’utilisation des comptes
Fiche 7 : Le journal, le grand livre
Fiche 8 : La balance
Fiche 9 : La normalisation et la réglementation comptables
Fiche 10 : Application de synthèse
Fiche 11 : Les achats de biens et services
Fiche 12 : Les ventes de biens et services
Fiche 13 : La rémunération du personnel
Fiche 14 : La TVA, les impôts et taxes, l’impôt sur le résultat
Fiche 15 : Les paiements et encaissements
Fiche 16 : Le suivi du compte « banque »
Fiche 17 : Les entrées d’immobilisations
Fiche 18 : Les valeurs mobilières de placement
Fiche 19 : Les capitaux propres
Fiche 20 : L’emprunt bancaire
Fiche 21 : Les subventions d’équilibre, d’exploitation et d’investissement
Fiche 22 : Principes d'évaluation à l'inventaire - Inventaire intermittent et variation des stocks
Fiche 23 : Les amortissements
Fiche 24 : Dépréciations et provisions
Fiche 25 : Ajustements de charges et de produits
Fiche 26 : Prise en compte des variations de change
Fiche 27 : Les sorties d’immobilisations
Fiche 28 : Clôture et réouverture des comptes - Notion d’affectation du résultat
Fiche 29 : Les documents de synthèse
Fiche 30 : Organisation pratique de la comptabilité
2
Fiche 1 : Définition et rôle de la comptabilité
« La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir,
classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture » (Plan comptable
général art.
120-1).
Elle permet de représenter les différentes opérations économiques et financières
qui se réalisent entre l’entité (entreprise ou autre organisation) et ses partenaires et de les traduire dans
des états financiers.
Pour simplifier, on peut dire que le rôle de la comptabilité est de fournir une image fidèle de la
situation financière et des résultats d’une entité.
A quoi sert la comptabilité ?
La comptabilité (appelée plus précisément « comptabilité générale » ou « comptabilité financière »)
est à la base de nombreuses communications aux tiers en relation à l’entité.
Les utilisateurs de la comptabilité sont essentiellement :
- l’entité elle-même ;
- les associés ;
- les investisseurs ;
- les administrations et notamment l’administration fiscale ;
- le personnel de l’entité ;
- les créanciers.
Information de l’entité
Toute personne associée, à quelque degré que ce soit, à la gestion de l’entreprise doit s’appuyer sur des
états comptables pour prendre ses décisions.
La comptabilité, tout au long de l’année, fournit aux
dirigeants de l’entreprise et à leurs collaborateurs les informations nécessaires :
- pour évaluer les ressources et le patrimoine de l’entreprise ;
- pour estimer la structure financière de l’entreprise ;
- pour apprécier la solvabilité de l’entreprise et le niveau de ses ressources disponibles ;
- pour analyser sa performance économique et ses résultats ;
- pour estimer sa capacité à s’adapter aux changements dans lequel elle opère ;
- pour effectuer ses prévisions.
Information des associés
Des informations d'ordre comptable doivent être mis à disposition (voire adressés) aux associés dans
les différents types de sociétés.
Il s'agit essentiellement :
- des comptes individuels (bilan, compte de résultat, annexe) appelés également (notamment par les
textes de droit comptable) « comptes annuels » ;
- des comptes consolidés, lorsque la société est tenue d'en établir.
Dans des entités à but non lucratif (associations, par exemple) des informations d’ordre comptable
doivent être mises à disposition des partenaires.
Information des investisseurs
Les investisseurs sont les personnes qui fournissent (ou sont susceptibles de fournir) des capitaux aux
entités.
Le cadre conceptuel 2010 de l’IASB (normalisateur comptable international) considère que
« l’objectif de l’information financière à usage général est de fournir au sujet de l’entité qui la présente
des informations utiles aux investisseurs en capitaux propres, aux prêteurs et aux autres créanciers
actuels et potentiels aux fins de leur prise de décisions en tant que fournisseurs de ressources de
l’entité » .
3
Les personnes qui fournissent les capitaux à risques et leurs conseillers sont concernés par le risque
inhérent à leurs investissements et par la rentabilité qu'ils produisent.
Ils ont besoin d'informations
pour les aider à déterminer quand ils doivent acheter, conserver, vendre.
Information des administrations
Les principales déclarations fiscales à souscrire par les entreprises concernent les impositions
suivantes :
- l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu, pour les personnes physiques ou impôt sur les
sociétés) ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle).
Les différentes déclarations doivent être établies à partir de la comptabilité.
Par ailleurs, les entités doivent présenter à l’Urssaf et autres organismes sociaux un certain nombre de
déclarations permettant de déterminer l’assiette.
Elles doivent aussi répondre aux enquêtes statistiques
agréées par les pouvoirs publics.
Information du personnel
Les membres du personnel et leurs représentants sont intéressés par une information sur la stabilité et
la rentabilité de l'entreprise qui les emploie.
Ils sont également intéressés par des informations qui leur
permettent d'estimer la capacité de l'entreprise à leur procurer une rémunération, des avantages en
matière de retraite et des opportunités en matière d'emploi
Chaque année, le chef d’entreprise doit présenter un certain nombre de documents comptables au
comité d’entreprise.
Information des créanciers
Les prêteurs sont intéressés par une information qui leur permette de déterminer si leurs prêts et les
intérêts qui y sont liés seront payés à l'échéance.
Les fournisseurs et autres créditeurs sont intéressés
par une information qui leur permette de déterminer si les montants qui leur sont dus leur seront payés
à l'échéance.
Comptabilité, contrôle de gestion, audit
Le contrôle de gestion est l'activité visant la maîtrise de la conduite d'une organisation en prévoyant les
événements et en s'adaptant à l'évolution, en définissant les objectifs, en mettant en place les moyens,
en comparant les performances et les objectifs, en corrigeant les objectifs et les moyens.
Il utilise des
outils de gestion au service du management de l'organisation.
Certains de ces outils, comme la
comptabilité analytique d’exploitation ou comptabilité de gestion, peuvent s’appuyer sur la
comptabilité.
La comptabilité analytique est un système de comptes, ajustés à la comptabilité générale,
permettant d’identifier et de valoriser les éléments constitutifs du résultat de l’exercice et d’en
permettre l’interprétation et l’exploitation.
Elle rapproche chaque produit de ses coûts, qu’ils aient été
encourus dans l’exercice ou dans des périodes précédentes.
Elle divise les résultats par centre de
décision permettant un meilleur pilotage, ou les consolide par ligne d’activité, afin de mieux en
apprécier la situation.
L'audit est une activité de contrôle et de conseil qui consiste en une expertise par un agent compétent
et impartial et un jugement sur l'organisation, la procédure, ou une opération quelconque de l'entité.
Il
permet de faire le point sur l'existant (état des lieux) afin d'en dégager les points faibles et/ou nonconformes (suivant les référentiels d'audit).
Cela, afin de mener par la suite les actions adéquates qui
permettront de corriger les écarts et dysfonctionnements constatés.
L'audit comptable et financier est
un examen des états financiers de l'entreprise, visant à vérifier leur sincérité, leur régularité, leur
conformité et leur aptitude à refléter l'image fidèle de l'entreprise.
Cet examen est effectué par un
professionnel indépendant, commissaire aux comptes ou auditeur.
4
Fiche 2 : Bilan et compte de résultat
Le bilan
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entité et fait apparaître de façon distincte
les capitaux propres.
• Un actif est une ressource contrôlée par l'entreprise du fait d'événements passés et dont des
avantages économiques futurs sont attendus par l'entreprise.
Les actifs d’une entité se composent
essentiellement de valeurs immobilisés (terrains, constructions, matériel, etc.), de stocks, de créances
et d’avoirs en trésorerie.
• Un passif est une obligation actuelle de l'entreprise résultant d'événements passés et dont l'extinction
devrait se traduire pour l'entreprise par une sortie de ressources représentatives d'avantages
économiques.
Les passifs d’une entité se composent essentiellement de dettes.
• Les capitaux propres sont l'intérêt résiduel dans les actifs de l'entreprise après déduction de tous ses
passifs.
Le compte de résultat
Le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l'exercice.
Selon le régime juridique de
l’entité, le solde des charges et des produits constitue :
- le bénéfice ou la perte de l’exercice ;
- l’excédent ou l’insuffisance de ressources.
• Les produits sont les accroissements d'avantages économiques au cours de l'exercice qui ont pour
résultat l'augmentation des capitaux propres autres que les augmentations provenant des apports des
participants aux capitaux propres.
• Les charges sont des diminutions d'avantages économiques au cours de l'exercice qui ont pour
résultat de diminuer les capitaux propres autrement que par des distributions aux participants aux
capitaux propres.
Application
1.
Etablissement d’un bilan
Vous....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Louis MÉNARD (1822-1901) (Recueil : Rêveries d'un païen mystique) - Initiation
- Jacques Julliard écrit dans le Nouvel Observateur, en juin 1988: A qui, débarqué d'une autre planète, voudrait gouter en une seule soirée à toutes nos névroses d'aujourd'hui, on ne saurait conseiller plus rapide initiation qu'un match de football. Il y trouverait réunies la plupart des maladies sociales dont nous souffrons: la violence, la triche, le fric et l'ennui. Qu'en pensez-vous ?
- Balzac, Le Père Goriot (Rastignac, une année d'initiation).
- En vous appuyant sur des exemples précis, vous direz quel rôle a joué dans votre découverte du monde et votre initiation à la vie?