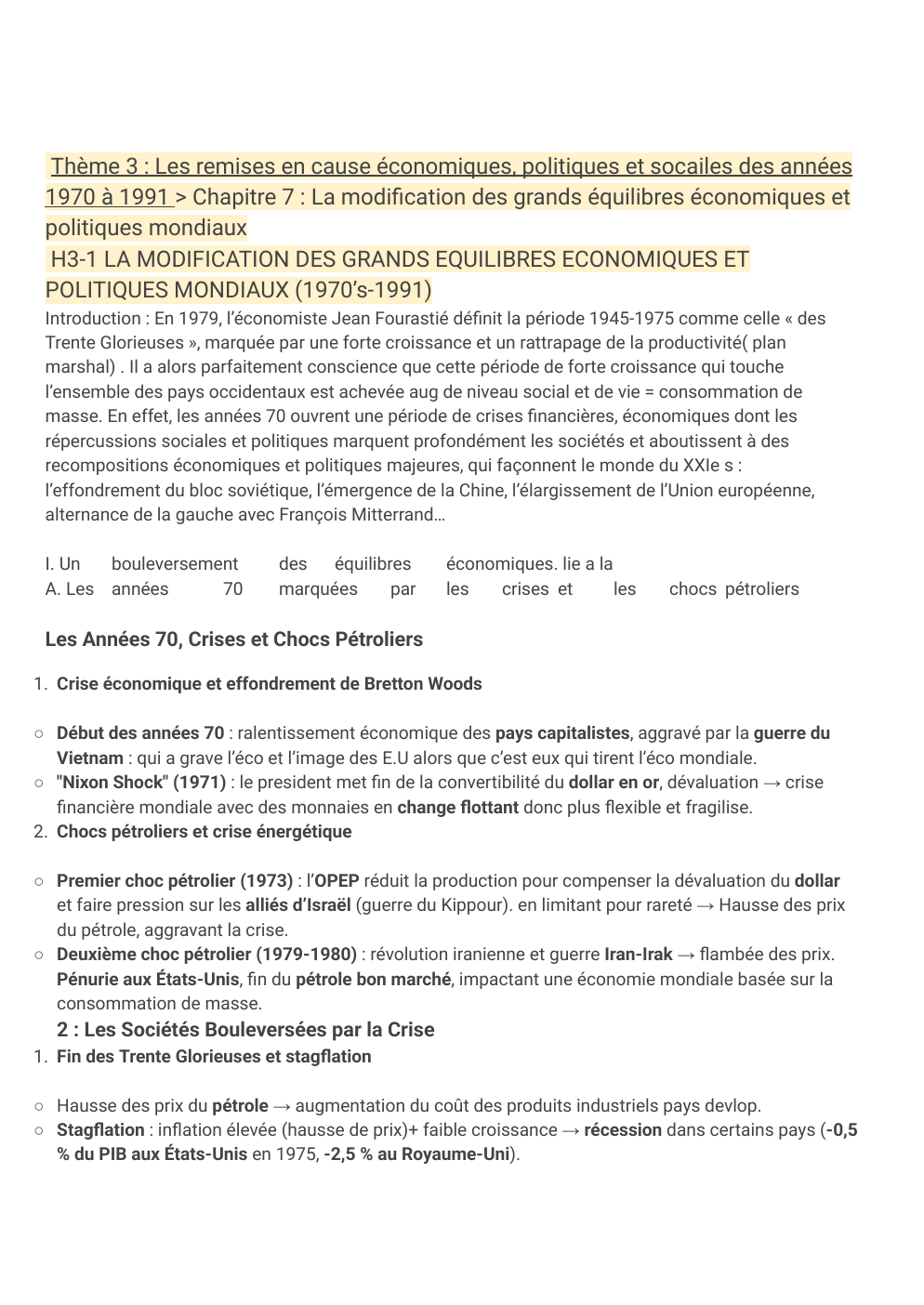H3-1 LA MODIFICATION DES GRANDS EQUILIBRES ECONOMIQUES ET POLITIQUES MONDIAUX (1970’s-1991)
Publié le 25/03/2025
Extrait du document
«
Thème 3 : Les remises en cause économiques, politiques et socailes des années
1970 à 1991 > Chapitre 7 : La modification des grands équilibres économiques et
politiques mondiaux
H3-1 LA MODIFICATION DES GRANDS EQUILIBRES ECONOMIQUES ET
POLITIQUES MONDIAUX (1970’s-1991)
Introduction : En 1979, l’économiste Jean Fourastié définit la période 1945-1975 comme celle « des
Trente Glorieuses », marquée par une forte croissance et un rattrapage de la productivité( plan
marshal) .
Il a alors parfaitement conscience que cette période de forte croissance qui touche
l’ensemble des pays occidentaux est achevée aug de niveau social et de vie = consommation de
masse.
En effet, les années 70 ouvrent une période de crises financières, économiques dont les
répercussions sociales et politiques marquent profondément les sociétés et aboutissent à des
recompositions économiques et politiques majeures, qui façonnent le monde du XXIe s :
l’effondrement du bloc soviétique, l’émergence de la Chine, l’élargissement de l’Union européenne,
alternance de la gauche avec François Mitterrand…
I.
Un bouleversement
des équilibres
économiques.
lie a la
A.
Les années
70
marquées
par les
crises et
les
chocs pétroliers
Les Années 70, Crises et Chocs Pétroliers
1. Crise économique et effondrement de Bretton Woods
○ Début des années 70 : ralentissement économique des pays capitalistes, aggravé par la guerre du
Vietnam : qui a grave l’éco et l’image des E.U alors que c’est eux qui tirent l’éco mondiale.
○ "Nixon Shock" (1971) : le president met fin de la convertibilité du dollar en or, dévaluation → crise
financière mondiale avec des monnaies en change flottant donc plus flexible et fragilise.
2. Chocs pétroliers et crise énergétique
○ Premier choc pétrolier (1973) : l’OPEP réduit la production pour compenser la dévaluation du dollar
et faire pression sur les alliés d’Israël (guerre du Kippour).
en limitant pour rareté → Hausse des prix
du pétrole, aggravant la crise.
○ Deuxième choc pétrolier (1979-1980) : révolution iranienne et guerre Iran-Irak → flambée des prix.
Pénurie aux États-Unis, fin du pétrole bon marché, impactant une économie mondiale basée sur la
consommation de masse.
2 : Les Sociétés Bouleversées par la Crise
1. Fin des Trente Glorieuses et stagflation
○ Hausse des prix du pétrole → augmentation du coût des produits industriels pays devlop.
○ Stagflation : inflation élevée (hausse de prix)+ faible croissance → récession dans certains pays (-0,5
% du PIB aux États-Unis en 1975, -2,5 % au Royaume-Uni).
○ Prise de conscience de la dépendance énergétique → campagnes anti-gaspillage et développement
du nucléaire pour pas être dépendant (ex : France).
2. Chômage de masse et crise industrielle
○ Délocalisations et automatisation pour réduire les coûts.= dvision internatio et FMN = vehicule la
mondialisation
○ Fermeture de secteurs peu rentables (ex : mines de charbon en France et au Royaume-Uni=
chômage fin 70).= pauvreté
○ Explosion du chômage (+10 % de la population active) → régions sinistrées (Pays de Galles, Nord de
la France, Lorraine).
Fin du plein-emploi des années 60.
3: Quelles Réponses à la Crise ? : politique
1. Échec des politiques économiques classiques
France : V gis Desteig
○ 1politique d’Austérité (ex : gouvernement Barre en France, 1976) → baisse des dépenses publiques,
plafonnement des salaires.= contrôler le budget de l’etat ; mais très impopulaire et chomage de
masse
○ Relance par la consommation tentée dans certains pays, mais déficits aggravés sans reprise
industrielle.
○ G6/G7 sommet (dès 1975) tentent une réponse économique coordonnée à la crise M en reunion.
2. Libéralisation et dérégulation
○ Portée par Thatcher (Royaume-Uni, 1979) et Reagan (États-Unis, 1980).
: Libéralisation de l’éco
○ Réduction du rôle de l’État, suppression des régulations du commerce mondial : règle eo malgre.
○ Effets : baisse de l’inflation et reprise partielle, mais aussi délocalisations massives et précarisation.
3. Nouvelle organisation du travail et ouverture de la Chine
○ Deng Xiaoping (1978) lance les Quatre Modernisations (agriculture, armée, industrie, recherche).
○ Création des ZES (Zones Économiques Spéciales) → délocalisations en Chine grâce à une
main-d’œuvre à bas coût= capitalisme d’etat pour mettre en place ce modèle économique= devient
l’atelier du monde.
○ Début de la Division Internationale du Travail (DIT) → accélération de la mondialisation.
Accroissement des échanges M
II.
Des bouleversements politiques profonds, entre rejet et
affirmationde
démocratie.
2: La Révolution Islamique en Iran et le Rejet du Modèle Occidental
1. Contexte et montée du rejet de l’Occident
○ L’Iran, dirigé par le Shah Mohammad Reza Pahlavi, est un allié clé des et soutenus par
États-Unis mais fragilisé par la crise économique des années 70.
la
○ Montée des inégalités et de l’opposition, notamment autour de l’Ayatollah Khomeyni etait en
exil, figure de l’islamisme politique va tire les ficelles a distance=
○ Après des manifestations et la répression, le Shah fuit en janvier 1979, ouvrant la voie au retour
de Khomeyni= E.U ne soutient pas
2. Naissance de la République Islamique (avril 1979)
○ Khomeyni instaure un régime théocratique : un président est élu, mais le Guide Suprême détient
le véritable pouvoir.
○ Mise en place d’un Conseil de surveillance des lois selon la charia.
○ Renforcement du pouvoir grâce au chiisme et à l’élimination des opposants.
3. Tensions avec l’Occident
○ Prise d’otages de l’ambassade américaine à Téhéran (novembre 1979) → humiliation des
États-Unis.
○ Guerre Iran-Irak (1980-1988) : Saddam Hussein attaque l’Iran, soutenu par l’Occident →
Khomeyni en sort renforcé.
○ L’Islam politique devient un moteur révolutionnaire et un rejet définitif du modèle occidental.
OPEP : (organisation des pays exportateurs de pétrole)
Pourquoi dévaluer une monnaie ? Une dévaluation compétitive consiste pour un pays à abaisser le taux de change de sa
monnaie au-delà de ce qui serait nécessaire pour tenir compte des données économiques de ce pays (croissance, productivité,
inflation, etc.) pour favoriser la compétitivité du pays
Un taux de change flottant correspond à une devise dont le cours est déterminé par des facteurs
d'offre et de demande relatifs à d'autres devises.
Un taux de change flottant diffère d'un taux de
change fixe, ou PEG, qui est entièrement déterminé par le gouvernement de la devise en
question.
H3-2 LA FRANCE DE 1974 A 1988 : UN TOURNANT SOCIAL, POLITIQUE ET
CULTUREL
Introduction : Après la démission de de Gaulle en 1969, son ancien Premier Ministre Georges Pompidou est élu
Président de la République.
Gravement malade, il décède en avril 1974, laissant un pays encore largement influencé
par les évènements de mai 68.
Sous les mandats de Valéry Giscard d’Estaing et de François Mitterrand (1974-1988),
la France va connaître une série de changements sociaux, politiques et culturels directement inspirés des
revendications étudiantes et ouvrières de mai 68, transformant profondément et durablement la France
I.
Un tournant politique : la barre à gauche
A.
Valéry Giscard d’Estaing, le Kennedy français
Après de Gaulle et Pompidou, la France cherche du renouveau : Valéry Giscard d’Estaing incarne cette modernité en 1974.
Inspiré de JFK, il adopte une posture proche du peuple (presente mediaie importante, petit-déjeuner avec les éboueurs).
Il favorise
une société plus ouverte avec des réformes :
●
●
●
Majorité abaissée à 18 ans (1974).
Création d’un secrétariat d’État à la condition féminine.
Modernisation du pays (ex : développement de La Défense).
Mais le contexte économique est difficile :
●
●
●
●
Crise pétrolière et Nixon Shock fragilisent la France.
Chômage double (1974-1981) atteignant 7 %.
Fermeture des mines en Lorraine et Nord, symboles de la crise.
Raymond Barre (1976) impose l’austérité : limitation des hausses de salaire, augmentation des impôts.
Face à la montée du chômage et aux tensions économiques, la gauche gagne en popularité.
B.
François Mitterrand, la victoire de la gauche
En 1981, François Mitterrand devient le premier président socialiste sous la Ve République.
Il met en place de grandes
réformes :
●
●
●
Abolition de la peine de mort (par le minstre Robert Badinter, 1981).
Hausse du SMIC, 5e semaine de congés payés, retraite à 60 ans.
Nationalisations massives et création de l’impôt sur les grandes fortunes.
Mais dès 1983, face aux déficits, il adopte une politique de rigueur avec Jacques Delors.
En 1986, la droite gagne les
législatives, entraînant la première cohabitation :
●
●
Jacques Chirac devient Premier ministre et mène une politique libérale (privatisations, modèle Thatcher/Reagan).
Montée du Front National, divisions internes à droite.
En 1988, Mitterrand est réélu pour un second mandat.
II.
Une société en mutation
A.
Un tournant pour la condition des femmes
Le féminisme se médiatise après mai 68.
En 1970, naissance du Mouvement de Libération des Femmes (MLF).
●
●
Loi Neuwirth (1967) : contraception généralisée.
Simone Veil (ministre en 1974) : lutte pour la dépénalisation de l’IVG et l’accès à la contraception remboursée.
●
●
●
Réformes : divorce par consentement mutuel, loi sur l’égalité salariale (non appliquée).
Indépendance financière croissante des femmes : 40 % des femmes mariées travaillent en 1970, 70 % en 1990.
Édith Cresson devient la première (et seule) femme Premier ministre en 1991.
B.
Une jeunesse en plein....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Littérature et engagements politiques (1930-1960)
- Anne de MARQUETS (1533-1588) - Ne jetez plus sur nous d'injures si grands sommes
- Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) (Recueil : Odes politiques) - Contre la peine de mort
- Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) (Recueil : Odes politiques) - A Némésis
- Joachim DU BELLAY (1522-1560) (Recueil : Les antiquités de Rome) - Ces grands monceaux pierreux, ces vieux murs que tu vois