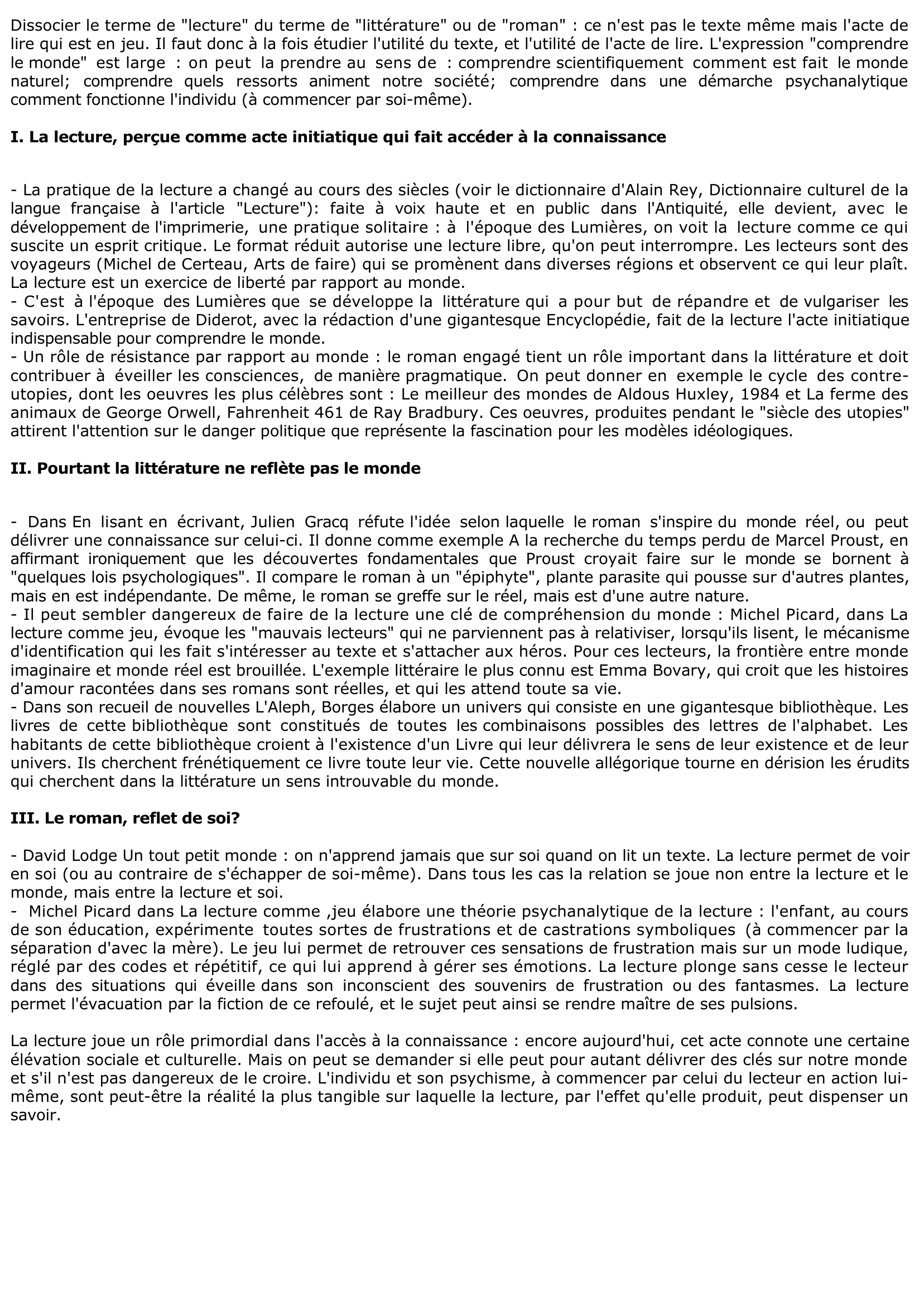La lecture permet-elle de comprendre le monde ?
Extrait du document
«
Dissocier le terme de "lecture" du terme de "littérature" ou de "roman" : ce n'est pas le texte même mais l'acte de
lire qui est en jeu.
Il faut donc à la fois étudier l'utilité du texte, et l'utilité de l'acte de lire.
L'expression "comprendre
le monde" est large : on peut la prendre au sens de : comprendre scientifiquement comment est fait le monde
naturel; comprendre quels ressorts animent notre société; comprendre dans une démarche psychanalytique
comment fonctionne l'individu (à commencer par soi-même).
I.
La lecture, perçue comme acte initiatique qui fait accéder à la connaissance
- La pratique de la lecture a changé au cours des siècles (voir le dictionnaire d'Alain Rey, Dictionnaire culturel de la
langue française à l'article "Lecture"): faite à voix haute et en public dans l'Antiquité, elle devient, avec le
développement de l'imprimerie, une pratique solitaire : à l'époque des Lumières, on voit la lecture comme ce qui
suscite un esprit critique.
Le format réduit autorise une lecture libre, qu'on peut interrompre.
Les lecteurs sont des
voyageurs (Michel de Certeau, Arts de faire) qui se promènent dans diverses régions et observent ce qui leur plaît.
La lecture est un exercice de liberté par rapport au monde.
- C'est à l'époque des Lumières que se développe la littérature qui a pour but de répandre et de vulgariser les
savoirs.
L'entreprise de Diderot, avec la rédaction d'une gigantesque Encyclopédie, fait de la lecture l'acte initiatique
indispensable pour comprendre le monde.
- Un rôle de résistance par rapport au monde : le roman engagé tient un rôle important dans la littérature et doit
contribuer à éveiller les consciences, de manière pragmatique.
On peut donner en exemple le cycle des contreutopies, dont les oeuvres les plus célèbres sont : Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, 1984 et La ferme des
animaux de George Orwell, Fahrenheit 461 de Ray Bradbury.
Ces oeuvres, produites pendant le "siècle des utopies"
attirent l'attention sur le danger politique que représente la fascination pour les modèles idéologiques.
II.
Pourtant la littérature ne reflète pas le monde
- Dans En lisant en écrivant, Julien Gracq réfute l'idée selon laquelle le roman s'inspire du monde réel, ou peut
délivrer une connaissance sur celui-ci.
Il donne comme exemple A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, en
affirmant ironiquement que les découvertes fondamentales que Proust croyait faire sur le monde se bornent à
"quelques lois psychologiques".
Il compare le roman à un "épiphyte", plante parasite qui pousse sur d'autres plantes,
mais en est indépendante.
De même, le roman se greffe sur le réel, mais est d'une autre nature.
- Il peut sembler dangereux de faire de la lecture une clé de compréhension du monde : Michel Picard, dans La
lecture comme jeu, évoque les "mauvais lecteurs" qui ne parviennent pas à relativiser, lorsqu'ils lisent, le mécanisme
d'identification qui les fait s'intéresser au texte et s'attacher aux héros.
Pour ces lecteurs, la frontière entre monde
imaginaire et monde réel est brouillée.
L'exemple littéraire le plus connu est Emma Bovary, qui croit que les histoires
d'amour racontées dans ses romans sont réelles, et qui les attend toute sa vie.
- Dans son recueil de nouvelles L'Aleph, Borges élabore un univers qui consiste en une gigantesque bibliothèque.
Les
livres de cette bibliothèque sont constitués de toutes les combinaisons possibles des lettres de l'alphabet.
Les
habitants de cette bibliothèque croient à l'existence d'un Livre qui leur délivrera le sens de leur existence et de leur
univers.
Ils cherchent frénétiquement ce livre toute leur vie.
Cette nouvelle allégorique tourne en dérision les érudits
qui cherchent dans la littérature un sens introuvable du monde.
III.
Le roman, reflet de soi?
- David Lodge Un tout petit monde : on n'apprend jamais que sur soi quand on lit un texte.
La lecture permet de voir
en soi (ou au contraire de s'échapper de soi-même).
Dans tous les cas la relation se joue non entre la lecture et le
monde, mais entre la lecture et soi.
- Michel Picard dans La lecture comme ,jeu élabore une théorie psychanalytique de la lecture : l'enfant, au cours
de son éducation, expérimente toutes sortes de frustrations et de castrations symboliques (à commencer par la
séparation d'avec la mère).
Le jeu lui permet de retrouver ces sensations de frustration mais sur un mode ludique,
réglé par des codes et répétitif, ce qui lui apprend à gérer ses émotions.
La lecture plonge sans cesse le lecteur
dans des situations qui éveille dans son inconscient des souvenirs de frustration ou des fantasmes.
La lecture
permet l'évacuation par la fiction de ce refoulé, et le sujet peut ainsi se rendre maître de ses pulsions.
La lecture joue un rôle primordial dans l'accès à la connaissance : encore aujourd'hui, cet acte connote une certaine
élévation sociale et culturelle.
Mais on peut se demander si elle peut pour autant délivrer des clés sur notre monde
et s'il n'est pas dangereux de le croire.
L'individu et son psychisme, à commencer par celui du lecteur en action luimême, sont peut-être la réalité la plus tangible sur laquelle la lecture, par l'effet qu'elle produit, peut dispenser un
savoir..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pensez-vous que la lecture de romans serve à mieux comprendre et le monde ?
- Pensez-vous que la lecture de romans serve à mieux comprendre l'homme et le monde ?
- Lecture linéaire 3 : les lettres elliptiques Jean Luc la garce juste la fin du monde
- Pour Antoine Adam, le théâtre de Racine représente « un monde cruel ; peuplé d'êtres passionnés et faibles, entraînés par les fatalités de leur sang ». Cette affirmation correspond-elle à la lecture Andromaque de Racine ?
- Dans son traité d'éducation, Émile, publié en 1762, Rousseau déclare à propos de l'utilisation, fréquente à l'époque, des Fables pour l'éducation morale des jeunes enfants : Composons M. de La Fontaine. Je promets quant à moi de vous lire, de vous aimer, de m'instruire dans vos fables, mais pour mon élève, permettez que je ne lui en laisse pas étudier une seule. Dans quelle mesure votre lecture personnelle du 2e recueil des Fables vous permet-elle de comprendre et de partager les réti