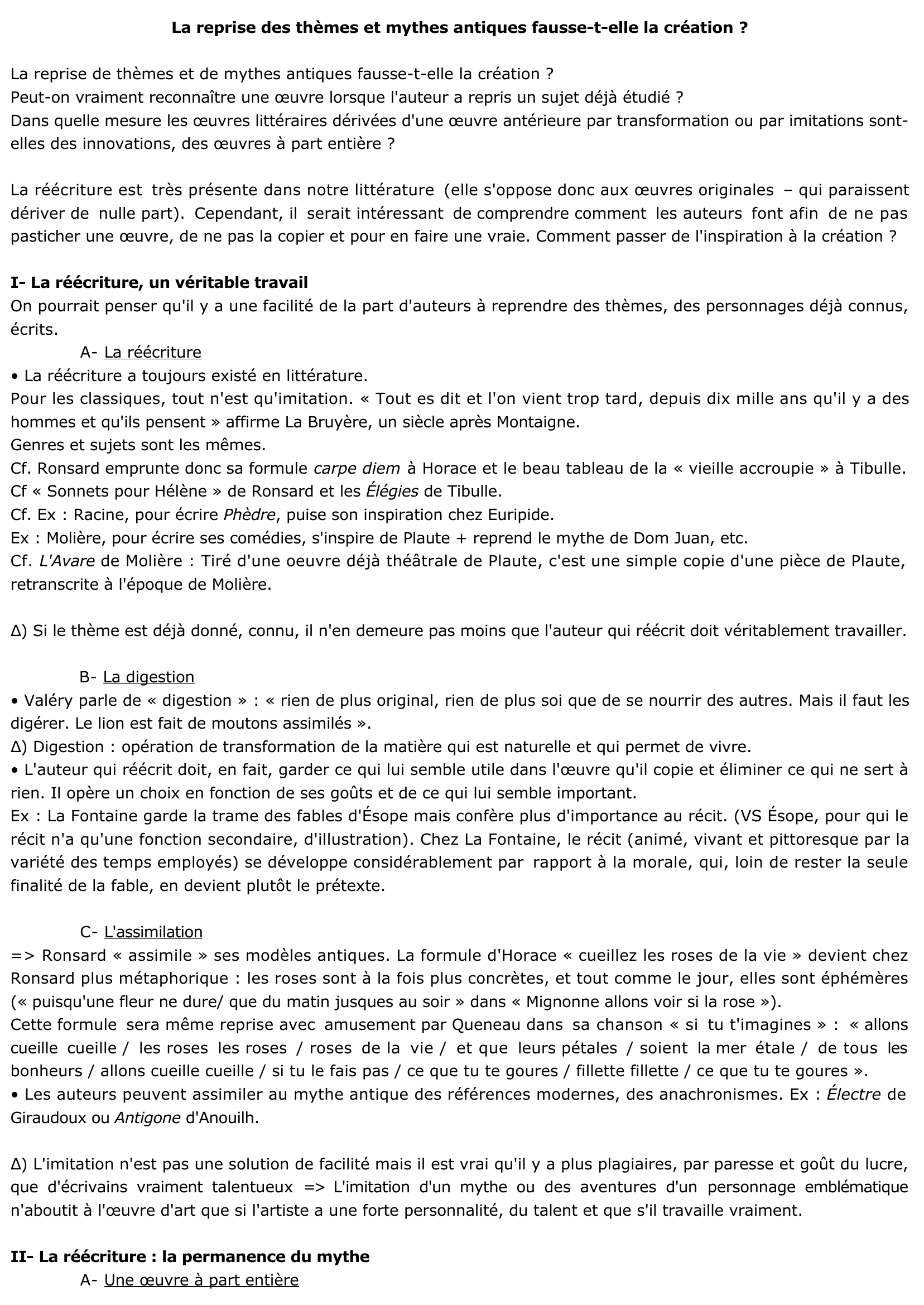La reprise des thèmes et mythes antiques fausse-t-elle la création ?
Extrait du document
«
La reprise des thèmes et mythes antiques fausse-t-elle la création ?
La reprise de thèmes et de mythes antiques fausse-t-elle la création ?
Peut-on vraiment reconnaître une œuvre lorsque l'auteur a repris un sujet déjà étudié ?
Dans quelle mesure les œuvres littéraires dérivées d'une œuvre antérieure par transformation ou par imitations sontelles des innovations, des œuvres à part entière ?
La réécriture est très présente dans notre littérature (elle s'oppose donc aux œuvres originales – qui paraissent
dériver de nulle part).
Cependant, il serait intéressant de comprendre comment les auteurs font afin de ne pas
pasticher une œuvre, de ne pas la copier et pour en faire une vraie.
Comment passer de l'inspiration à la création ?
I- La réécriture, un véritable travail
On pourrait penser qu'il y a une facilité de la part d'auteurs à reprendre des thèmes, des personnages déjà connus,
écrits.
A- La réécriture
• La réécriture a toujours existé en littérature.
Pour les classiques, tout n'est qu'imitation.
« Tout es dit et l'on vient trop tard, depuis dix mille ans qu'il y a des
hommes et qu'ils pensent » affirme La Bruyère, un siècle après Montaigne.
Genres et sujets sont les mêmes.
Cf.
Ronsard emprunte donc sa formule carpe diem à Horace et le beau tableau de la « vieille accroupie » à Tibulle.
Cf « Sonnets pour Hélène » de Ronsard et les Élégies de Tibulle.
Cf.
Ex : Racine, pour écrire Phèdre, puise son inspiration chez Euripide.
Ex : Molière, pour écrire ses comédies, s'inspire de Plaute + reprend le mythe de Dom Juan, etc.
Cf.
L'Avare de Molière : Tiré d'une oeuvre déjà théâtrale de Plaute, c'est une simple copie d'une pièce de Plaute,
retranscrite à l'époque de Molière.
∆) Si le thème est déjà donné, connu, il n'en demeure pas moins que l'auteur qui réécrit doit véritablement travailler.
B- La digestion
• Valéry parle de « digestion » : « rien de plus original, rien de plus soi que de se nourrir des autres.
Mais il faut les
digérer.
Le lion est fait de moutons assimilés ».
∆) Digestion : opération de transformation de la matière qui est naturelle et qui permet de vivre.
• L'auteur qui réécrit doit, en fait, garder ce qui lui semble utile dans l'œuvre qu'il copie et éliminer ce qui ne sert à
rien.
Il opère un choix en fonction de ses goûts et de ce qui lui semble important.
Ex : La Fontaine garde la trame des fables d'Ésope mais confère plus d'importance au récit.
(VS Ésope, pour qui le
récit n'a qu'une fonction secondaire, d'illustration).
Chez La Fontaine, le récit (animé, vivant et pittoresque par la
variété des temps employés) se développe considérablement par rapport à la morale, qui, loin de rester la seule
finalité de la fable, en devient plutôt le prétexte.
C- L'assimilation
=> Ronsard « assimile » ses modèles antiques.
La formule d'Horace « cueillez les roses de la vie » devient chez
Ronsard plus métaphorique : les roses sont à la fois plus concrètes, et tout comme le jour, elles sont éphémères
(« puisqu'une fleur ne dure/ que du matin jusques au soir » dans « Mignonne allons voir si la rose »).
Cette formule sera même reprise avec amusement par Queneau dans sa chanson « si tu t'imagines » : « allons
cueille cueille / les roses les roses / roses de la vie / et que leurs pétales / soient la mer étale / de tous les
bonheurs / allons cueille cueille / si tu le fais pas / ce que tu te goures / fillette fillette / ce que tu te goures ».
• Les auteurs peuvent assimiler au mythe antique des références modernes, des anachronismes.
Ex : Électre de
Giraudoux ou Antigone d'Anouilh.
∆) L'imitation n'est pas une solution de facilité mais il est vrai qu'il y a plus plagiaires, par paresse et goût du lucre,
que d'écrivains vraiment talentueux => L'imitation d'un mythe ou des aventures d'un personnage emblématique
n'aboutit à l'œuvre d'art que si l'artiste a une forte personnalité, du talent et que s'il travaille vraiment.
II- La réécriture : la permanence du mythe
A- Une œuvre à part entière.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les grands écrivains sont considérés comme des créateurs. La reprise de mythes antiques dans les tragédies depuis le 17e siècle permet-elle d'employer ce terme pour les auteurs de théâtre ?
- Seriez-vous aussi sévère qu'un critique affirmant, à propos de la reprise des mythes antiques par les dramaturges modernes : « Il y a une étonnante mesquinerie à rapetisser ainsi ces grandes figures qui, sur la route de l'humanité, incarnent nos éternelles passions. » ? Pour répondre, vous vous appuierez sur la pièce étudiée cette année ?
- Selon Pierre-Henri Simon, « l'exploitation moderne des mythes antiques » se fait généralement de la façon suivante: l'auteur moderne cherche à «y trouver, pour l'intelligence de l'homme du xxe siècle, un prétexte de réflexion et un jeu de symboles, en l'amusant d'ailleurs par la virtuosité de la transposition » (Théâtre et destin, 1959).
- Pourquoi sommes-nous fascinés par des histoires que nous connaissons déjà, qu'il s'agisse de mythes antiques ou modernes ?
- Par définition, un mythe est un récit perpétuellement soumis à la réécriture. D'où vient que nous sommes ainsi fascinés par des histoires que nous connaissons déjà, qu'il s'agisse de mythes antiques (Oedipe, Antigone, Électre...) ou de mythes modernes (Robinson Crusoé, Don Juan, Faust) ?