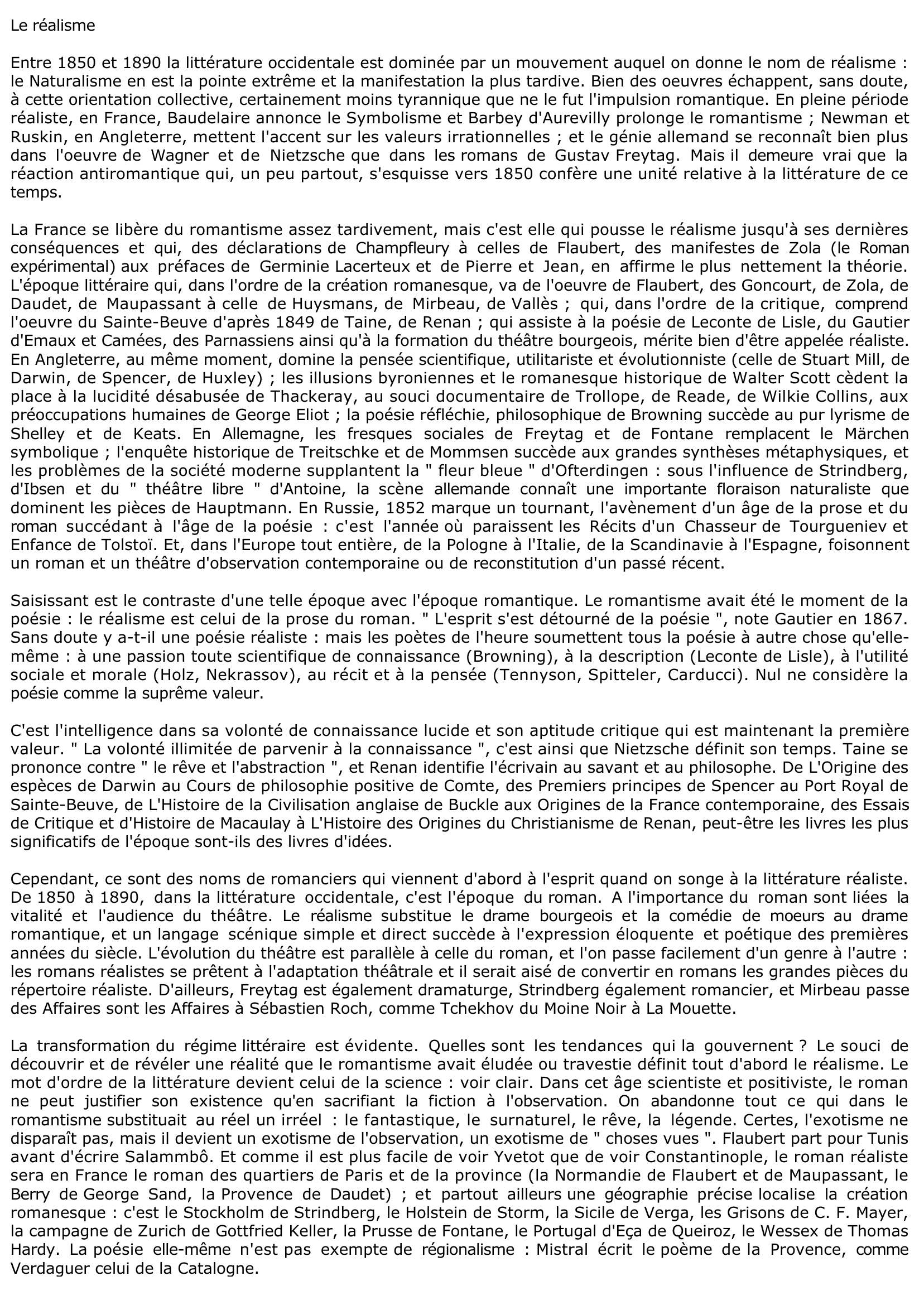Le réalisme
Extrait du document
«
Le réalisme
Entre 1850 et 1890 la littérature occidentale est dominée par un mouvement auquel on donne le nom de réalisme :
le Naturalisme en est la pointe extrême et la manifestation la plus tardive.
Bien des oeuvres échappent, sans doute,
à cette orientation collective, certainement moins tyrannique que ne le fut l'impulsion romantique.
En pleine période
réaliste, en France, Baudelaire annonce le Symbolisme et Barbey d'Aurevilly prolonge le romantisme ; Newman et
Ruskin, en Angleterre, mettent l'accent sur les valeurs irrationnelles ; et le génie allemand se reconnaît bien plus
dans l'oeuvre de Wagner et de Nietzsche que dans les romans de Gustav Freytag.
Mais il demeure vrai que la
réaction antiromantique qui, un peu partout, s'esquisse vers 1850 confère une unité relative à la littérature de ce
temps.
La France se libère du romantisme assez tardivement, mais c'est elle qui pousse le réalisme jusqu'à ses dernières
conséquences et qui, des déclarations de Champfleury à celles de Flaubert, des manifestes de Zola (le Roman
expérimental) aux préfaces de Germinie Lacerteux et de Pierre et Jean, en affirme le plus nettement la théorie.
L'époque littéraire qui, dans l'ordre de la création romanesque, va de l'oeuvre de Flaubert, des Goncourt, de Zola, de
Daudet, de Maupassant à celle de Huysmans, de Mirbeau, de Vallès ; qui, dans l'ordre de la critique, comprend
l'oeuvre du Sainte-Beuve d'après 1849 de Taine, de Renan ; qui assiste à la poésie de Leconte de Lisle, du Gautier
d'Emaux et Camées, des Parnassiens ainsi qu'à la formation du théâtre bourgeois, mérite bien d'être appelée réaliste.
En Angleterre, au même moment, domine la pensée scientifique, utilitariste et évolutionniste (celle de Stuart Mill, de
Darwin, de Spencer, de Huxley) ; les illusions byroniennes et le romanesque historique de Walter Scott cèdent la
place à la lucidité désabusée de Thackeray, au souci documentaire de Trollope, de Reade, de Wilkie Collins, aux
préoccupations humaines de George Eliot ; la poésie réfléchie, philosophique de Browning succède au pur lyrisme de
Shelley et de Keats.
En Allemagne, les fresques sociales de Freytag et de Fontane remplacent le Märchen
symbolique ; l'enquête historique de Treitschke et de Mommsen succède aux grandes synthèses métaphysiques, et
les problèmes de la société moderne supplantent la " fleur bleue " d'Ofterdingen : sous l'influence de Strindberg,
d'Ibsen et du " théâtre libre " d'Antoine, la scène allemande connaît une importante floraison naturaliste que
dominent les pièces de Hauptmann.
En Russie, 1852 marque un tournant, l'avènement d'un âge de la prose et du
roman succédant à l'âge de la poésie : c'est l'année où paraissent les Récits d'un Chasseur de Tourgueniev et
Enfance de Tolstoï.
Et, dans l'Europe tout entière, de la Pologne à l'Italie, de la Scandinavie à l'Espagne, foisonnent
un roman et un théâtre d'observation contemporaine ou de reconstitution d'un passé récent.
Saisissant est le contraste d'une telle époque avec l'époque romantique.
Le romantisme avait été le moment de la
poésie : le réalisme est celui de la prose du roman.
" L'esprit s'est détourné de la poésie ", note Gautier en 1867.
Sans doute y a-t-il une poésie réaliste : mais les poètes de l'heure soumettent tous la poésie à autre chose qu'ellemême : à une passion toute scientifique de connaissance (Browning), à la description (Leconte de Lisle), à l'utilité
sociale et morale (Holz, Nekrassov), au récit et à la pensée (Tennyson, Spitteler, Carducci).
Nul ne considère la
poésie comme la suprême valeur.
C'est l'intelligence dans sa volonté de connaissance lucide et son aptitude critique qui est maintenant la première
valeur.
" La volonté illimitée de parvenir à la connaissance ", c'est ainsi que Nietzsche définit son temps.
Taine se
prononce contre " le rêve et l'abstraction ", et Renan identifie l'écrivain au savant et au philosophe.
De L'Origine des
espèces de Darwin au Cours de philosophie positive de Comte, des Premiers principes de Spencer au Port Royal de
Sainte-Beuve, de L'Histoire de la Civilisation anglaise de Buckle aux Origines de la France contemporaine, des Essais
de Critique et d'Histoire de Macaulay à L'Histoire des Origines du Christianisme de Renan, peut-être les livres les plus
significatifs de l'époque sont-ils des livres d'idées.
Cependant, ce sont des noms de romanciers qui viennent d'abord à l'esprit quand on songe à la littérature réaliste.
De 1850 à 1890, dans la littérature occidentale, c'est l'époque du roman.
A l'importance du roman sont liées la
vitalité et l'audience du théâtre.
Le réalisme substitue le drame bourgeois et la comédie de moeurs au drame
romantique, et un langage scénique simple et direct succède à l'expression éloquente et poétique des premières
années du siècle.
L'évolution du théâtre est parallèle à celle du roman, et l'on passe facilement d'un genre à l'autre :
les romans réalistes se prêtent à l'adaptation théâtrale et il serait aisé de convertir en romans les grandes pièces du
répertoire réaliste.
D'ailleurs, Freytag est également dramaturge, Strindberg également romancier, et Mirbeau passe
des Affaires sont les Affaires à Sébastien Roch, comme Tchekhov du Moine Noir à La Mouette.
La transformation du régime littéraire est évidente.
Quelles sont les tendances qui la gouvernent ? Le souci de
découvrir et de révéler une réalité que le romantisme avait éludée ou travestie définit tout d'abord le réalisme.
Le
mot d'ordre de la littérature devient celui de la science : voir clair.
Dans cet âge scientiste et positiviste, le roman
ne peut justifier son existence qu'en sacrifiant la fiction à l'observation.
On abandonne tout ce qui dans le
romantisme substituait au réel un irréel : le fantastique, le surnaturel, le rêve, la légende.
Certes, l'exotisme ne
disparaît pas, mais il devient un exotisme de l'observation, un exotisme de " choses vues ".
Flaubert part pour Tunis
avant d'écrire Salammbô.
Et comme il est plus facile de voir Yvetot que de voir Constantinople, le roman réaliste
sera en France le roman des quartiers de Paris et de la province (la Normandie de Flaubert et de Maupassant, le
Berry de George Sand, la Provence de Daudet) ; et partout ailleurs une géographie précise localise la création
romanesque : c'est le Stockholm de Strindberg, le Holstein de Storm, la Sicile de Verga, les Grisons de C.
F.
Mayer,
la campagne de Zurich de Gottfried Keller, la Prusse de Fontane, le Portugal d'Eça de Queiroz, le Wessex de Thomas
Hardy.
La poésie elle-même n'est pas exempte de régionalisme : Mistral écrit le poème de la Provence, comme
Verdaguer celui de la Catalogne..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE RÉALISME en littérature
- Stendhal (1783-1842) ou le réalisme subjectif
- Edmond DE GONCOURT écrit, dans la préface des Frères Zemganno (1879) : Le réalisme, pour user du mot bête, du mot-drapeau, n'a pas l'unique mission de décrire ce qui est bas, ce qui est répugnant, ce qui pue. Il est venu au monde aussi, lui, pour définir dans de « l'écriture artiste » ce qui est élevé, ce qui est joli, ce qui sent bon, et encore pour donner les aspects et les profils des êtres raffinés et des choses riches : mais cela en vue d'une étude appliquée, rigoureuse et non con
- Flaubert (1821-1880) ou le réalisme esthétique
- Balzac (1799-1850) ou le réalisme totalisant