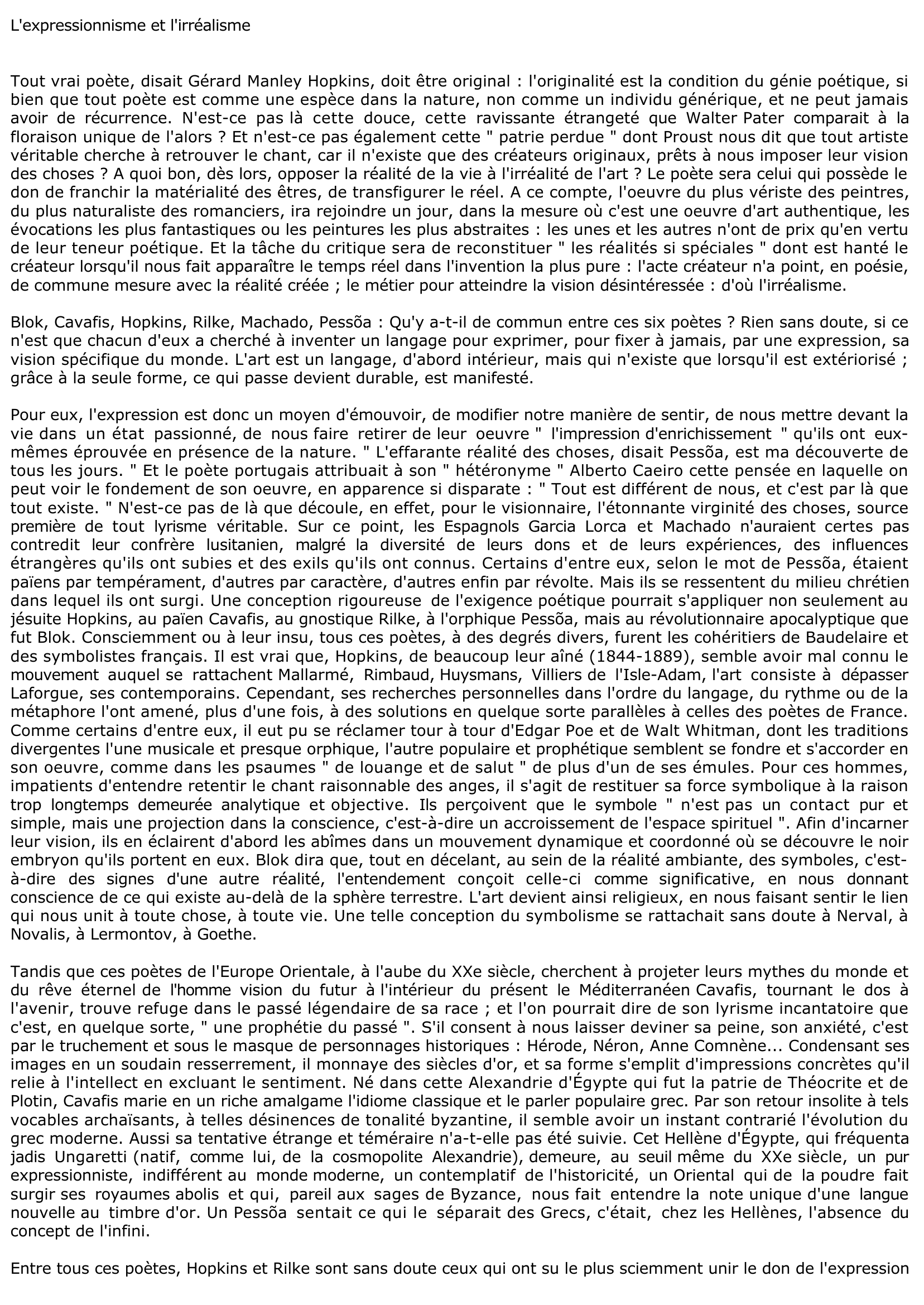L'expressionnisme et l'irréalisme
Extrait du document
«
L'expressionnisme et l'irréalisme
Tout vrai poète, disait Gérard Manley Hopkins, doit être original : l'originalité est la condition du génie poétique, si
bien que tout poète est comme une espèce dans la nature, non comme un individu générique, et ne peut jamais
avoir de récurrence.
N'est-ce pas là cette douce, cette ravissante étrangeté que Walter Pater comparait à la
floraison unique de l'alors ? Et n'est-ce pas également cette " patrie perdue " dont Proust nous dit que tout artiste
véritable cherche à retrouver le chant, car il n'existe que des créateurs originaux, prêts à nous imposer leur vision
des choses ? A quoi bon, dès lors, opposer la réalité de la vie à l'irréalité de l'art ? Le poète sera celui qui possède le
don de franchir la matérialité des êtres, de transfigurer le réel.
A ce compte, l'oeuvre du plus vériste des peintres,
du plus naturaliste des romanciers, ira rejoindre un jour, dans la mesure où c'est une oeuvre d'art authentique, les
évocations les plus fantastiques ou les peintures les plus abstraites : les unes et les autres n'ont de prix qu'en vertu
de leur teneur poétique.
Et la tâche du critique sera de reconstituer " les réalités si spéciales " dont est hanté le
créateur lorsqu'il nous fait apparaître le temps réel dans l'invention la plus pure : l'acte créateur n'a point, en poésie,
de commune mesure avec la réalité créée ; le métier pour atteindre la vision désintéressée : d'où l'irréalisme.
Blok, Cavafis, Hopkins, Rilke, Machado, Pessõa : Qu'y a-t-il de commun entre ces six poètes ? Rien sans doute, si ce
n'est que chacun d'eux a cherché à inventer un langage pour exprimer, pour fixer à jamais, par une expression, sa
vision spécifique du monde.
L'art est un langage, d'abord intérieur, mais qui n'existe que lorsqu'il est extériorisé ;
grâce à la seule forme, ce qui passe devient durable, est manifesté.
Pour eux, l'expression est donc un moyen d'émouvoir, de modifier notre manière de sentir, de nous mettre devant la
vie dans un état passionné, de nous faire retirer de leur oeuvre " l'impression d'enrichissement " qu'ils ont euxmêmes éprouvée en présence de la nature.
" L'effarante réalité des choses, disait Pessõa, est ma découverte de
tous les jours.
" Et le poète portugais attribuait à son " hétéronyme " Alberto Caeiro cette pensée en laquelle on
peut voir le fondement de son oeuvre, en apparence si disparate : " Tout est différent de nous, et c'est par là que
tout existe.
" N'est-ce pas de là que découle, en effet, pour le visionnaire, l'étonnante virginité des choses, source
première de tout lyrisme véritable.
Sur ce point, les Espagnols Garcia Lorca et Machado n'auraient certes pas
contredit leur confrère lusitanien, malgré la diversité de leurs dons et de leurs expériences, des influences
étrangères qu'ils ont subies et des exils qu'ils ont connus.
Certains d'entre eux, selon le mot de Pessõa, étaient
païens par tempérament, d'autres par caractère, d'autres enfin par révolte.
Mais ils se ressentent du milieu chrétien
dans lequel ils ont surgi.
Une conception rigoureuse de l'exigence poétique pourrait s'appliquer non seulement au
jésuite Hopkins, au païen Cavafis, au gnostique Rilke, à l'orphique Pessõa, mais au révolutionnaire apocalyptique que
fut Blok.
Consciemment ou à leur insu, tous ces poètes, à des degrés divers, furent les cohéritiers de Baudelaire et
des symbolistes français.
Il est vrai que, Hopkins, de beaucoup leur aîné (1844-1889), semble avoir mal connu le
mouvement auquel se rattachent Mallarmé, Rimbaud, Huysmans, Villiers de l'Isle-Adam, l'art consiste à dépasser
Laforgue, ses contemporains.
Cependant, ses recherches personnelles dans l'ordre du langage, du rythme ou de la
métaphore l'ont amené, plus d'une fois, à des solutions en quelque sorte parallèles à celles des poètes de France.
Comme certains d'entre eux, il eut pu se réclamer tour à tour d'Edgar Poe et de Walt Whitman, dont les traditions
divergentes l'une musicale et presque orphique, l'autre populaire et prophétique semblent se fondre et s'accorder en
son oeuvre, comme dans les psaumes " de louange et de salut " de plus d'un de ses émules.
Pour ces hommes,
impatients d'entendre retentir le chant raisonnable des anges, il s'agit de restituer sa force symbolique à la raison
trop longtemps demeurée analytique et objective.
Ils perçoivent que le symbole " n'est pas un contact pur et
simple, mais une projection dans la conscience, c'est-à-dire un accroissement de l'espace spirituel ".
Afin d'incarner
leur vision, ils en éclairent d'abord les abîmes dans un mouvement dynamique et coordonné où se découvre le noir
embryon qu'ils portent en eux.
Blok dira que, tout en décelant, au sein de la réalité ambiante, des symboles, c'està-dire des signes d'une autre réalité, l'entendement conçoit celle-ci comme significative, en nous donnant
conscience de ce qui existe au-delà de la sphère terrestre.
L'art devient ainsi religieux, en nous faisant sentir le lien
qui nous unit à toute chose, à toute vie.
Une telle conception du symbolisme se rattachait sans doute à Nerval, à
Novalis, à Lermontov, à Goethe.
Tandis que ces poètes de l'Europe Orientale, à l'aube du XXe siècle, cherchent à projeter leurs mythes du monde et
du rêve éternel de l'homme vision du futur à l'intérieur du présent le Méditerranéen Cavafis, tournant le dos à
l'avenir, trouve refuge dans le passé légendaire de sa race ; et l'on pourrait dire de son lyrisme incantatoire que
c'est, en quelque sorte, " une prophétie du passé ".
S'il consent à nous laisser deviner sa peine, son anxiété, c'est
par le truchement et sous le masque de personnages historiques : Hérode, Néron, Anne Comnène...
Condensant ses
images en un soudain resserrement, il monnaye des siècles d'or, et sa forme s'emplit d'impressions concrètes qu'il
relie à l'intellect en excluant le sentiment.
Né dans cette Alexandrie d'Égypte qui fut la patrie de Théocrite et de
Plotin, Cavafis marie en un riche amalgame l'idiome classique et le parler populaire grec.
Par son retour insolite à tels
vocables archaïsants, à telles désinences de tonalité byzantine, il semble avoir un instant contrarié l'évolution du
grec moderne.
Aussi sa tentative étrange et téméraire n'a-t-elle pas été suivie.
Cet Hellène d'Égypte, qui fréquenta
jadis Ungaretti (natif, comme lui, de la cosmopolite Alexandrie), demeure, au seuil même du XXe siècle, un pur
expressionniste, indifférent au monde moderne, un contemplatif de l'historicité, un Oriental qui de la poudre fait
surgir ses royaumes abolis et qui, pareil aux sages de Byzance, nous fait entendre la note unique d'une langue
nouvelle au timbre d'or.
Un Pessõa sentait ce qui le séparait des Grecs, c'était, chez les Hellènes, l'absence du
concept de l'infini.
Entre tous ces poètes, Hopkins et Rilke sont sans doute ceux qui ont su le plus sciemment unir le don de l'expression.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓