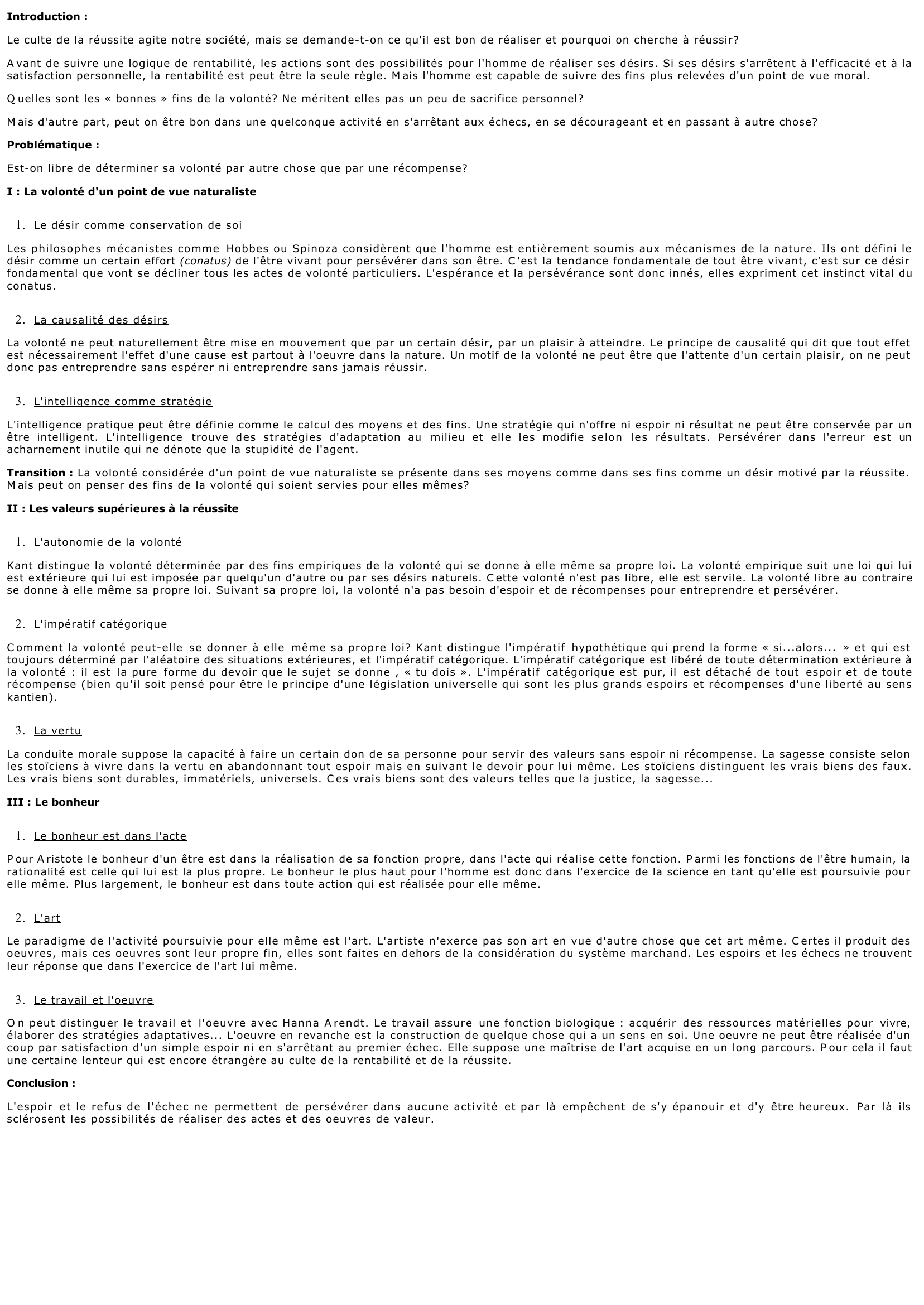« Point n'est nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ». Commentez ?
Extrait du document
«
Introduction :
Le culte de la réussite agite notre société, mais se demande-t-on ce qu'il est bon de réaliser et pourquoi on cherche à réussir?
A vant de suivre une logique de rentabilité, les actions sont des possibilités pour l'homme de réaliser ses désirs.
Si ses désirs s'arrêtent à l'efficacité et à la
satisfaction personnelle, la rentabilité est peut être la seule règle.
M ais l'homme est capable de suivre des fins plus relevées d'un point de vue moral.
Q uelles sont les « bonnes » fins de la volonté? Ne méritent elles pas un peu de sacrifice personnel?
M ais d'autre part, peut on être bon dans une quelconque activité en s'arrêtant aux échecs, en se décourageant et en passant à autre chose?
Problématique :
Est-on libre de déterminer sa volonté par autre chose que par une récompense?
I : La volonté d'un point de vue naturaliste
1.
Le désir comme conservation de soi
Les philosophes mécanistes comme Hobbes ou Spinoza considèrent que l'homme est entièrement soumis aux mécanismes de la nature.
Ils ont défini le
désir comme un certain effort (conatus) de l'être vivant pour persévérer dans son être.
C 'est la tendance fondamentale de tout être vivant, c'est sur ce désir
fondamental que vont se décliner tous les actes de volonté particuliers.
L'espérance et la persévérance sont donc innés, elles expriment cet instinct vital du
conatus.
2.
La causalité des désirs
La volonté ne peut naturellement être mise en mouvement que par un certain désir, par un plaisir à atteindre.
Le principe de causalité qui dit que tout effet
est nécessairement l'effet d'une cause est partout à l'oeuvre dans la nature.
Un motif de la volonté ne peut être que l'attente d'un certain plaisir, on ne peut
donc pas entreprendre sans espérer ni entreprendre sans jamais réussir.
3.
L'intelligence comme stratégie
L'intelligence pratique peut être définie comme le calcul des moyens et des fins.
Une stratégie qui n'offre ni espoir ni résultat ne peut être conservée par un
être intelligent.
L'intelligence trouve des stratégies d'adaptation au milieu et elle les modifie selon l e s résultats.
Persévérer dans l'erreur est un
acharnement inutile qui ne dénote que la stupidité de l'agent.
Transition : La volonté considérée d'un point de vue naturaliste se présente dans ses moyens comme dans ses fins comme un désir motivé par la réussite.
M ais peut on penser des fins de la volonté qui soient servies pour elles mêmes?
II : Les valeurs supérieures à la réussite
1.
L'autonomie de la volonté
Kant distingue la volonté déterminée par des fins empiriques de la volonté qui se donne à elle même sa propre loi.
La volonté empirique suit une loi qui lui
est extérieure qui lui est imposée par quelqu'un d'autre ou par ses désirs naturels.
C ette volonté n'est pas libre, elle est servile.
La volonté libre au contraire
se donne à elle même sa propre loi.
Suivant sa propre loi, la volonté n'a pas besoin d'espoir et de récompenses pour entreprendre et persévérer.
2.
L'impératif catégorique
C omment la volonté peut-elle se donner à elle même sa propre loi? Kant distingue l'impératif hypothétique qui prend la forme « si...alors...
» et qui est
toujours déterminé par l'aléatoire des situations extérieures, et l'impératif catégorique.
L'impératif catégorique est libéré de toute détermination extérieure à
la volonté : il est la pure forme du devoir que le sujet se donne , « tu dois ».
L'impératif catégorique est pur, il est détaché de tout espoir et de toute
récompense (bien qu'il soit pensé pour être le principe d'une législation universelle qui sont les plus grands espoirs et récompenses d'une liberté au sens
kantien).
3.
La vertu
La conduite morale suppose la capacité à faire un certain don de sa personne pour servir des valeurs sans espoir ni récompense.
La sagesse consiste selon
les stoïciens à vivre dans la vertu en abandonnant tout espoir mais en suivant le devoir pour lui même.
Les stoïciens distinguent les vrais biens des faux.
Les vrais biens sont durables, immatériels, universels.
C es vrais biens sont des valeurs telles que la justice, la sagesse...
III : Le bonheur
1.
Le bonheur est dans l'acte
P our A ristote le bonheur d'un être est dans la réalisation de sa fonction propre, dans l'acte qui réalise cette fonction.
P armi les fonctions de l'être humain, la
rationalité est celle qui lui est la plus propre.
Le bonheur le plus haut pour l'homme est donc dans l'exercice de la science en tant qu'elle est poursuivie pour
elle même.
Plus largement, le bonheur est dans toute action qui est réalisée pour elle même.
2.
L'art
Le paradigme de l'activité poursuivie pour elle même est l'art.
L'artiste n'exerce pas son art en vue d'autre chose que cet art même.
C ertes il produit des
oeuvres, mais ces oeuvres sont leur propre fin, elles sont faites en dehors de la considération du système marchand.
Les espoirs et les échecs ne trouvent
leur réponse que dans l'exercice de l'art lui même.
3.
Le travail et l'oeuvre
O n peut distinguer le travail et l'oeuvre avec Hanna A rendt.
Le travail assure une fonction biologique : acquérir des ressources matérielles pour vivre,
élaborer des stratégies adaptatives...
L'oeuvre en revanche est la construction de quelque chose qui a un sens en soi.
Une oeuvre ne peut être réalisée d'un
coup par satisfaction d'un simple espoir ni en s'arrêtant au premier échec.
Elle suppose une maîtrise de l'art acquise en un long parcours.
P our cela il faut
une certaine lenteur qui est encore étrangère au culte de la rentabilité et de la réussite.
Conclusion :
L'espoir et le refus de l'échec ne permettent de persévérer dans aucune activité et par là empêchent de s'y épanouir et d'y être heureux.
Par là ils
sclérosent les possibilités de réaliser des actes et des oeuvres de valeur..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Parlant du monde et de ses personnages, Albert Camus écrit dans l'Homme révolté : Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n'est ni plus beau, ni plus édifiant que le nôtre. Mais eux, du moins, courent jusqu'au bout de leur destin et il n'est jamais de si bouleversant héros que ceux qui vont jusqu'à l'extrémité de leurs passions. Vous expliciterez et illustrerez ce point de vue à partir de vos lectures romanesques et vous le discuterez si cela vous semble n
- Commentez cette indication d'André Gide : « Je suis un être de dialogue et non point d'affirmation. »
- En vous appuyant sur votre connaissance et sur votre sensibilité, vous expliquerez et discuterez ce point de vue sur la poésie formulé par Claude Roy lors de sa réception du premier Goncourt de la poésie en septembre 1985 : Aussi vaine que les nuages, aussi nécessaire que le pain, la poésie n'est pas forcément une maîtresse d'illusions. Elle peut être aussi, elle doit être surtout la réalité profonde prise aux mots, une vérité qui se fait chant ?
- Commentez et discutez ces lignes de Baudelaire : « L'art est-il utile? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il est l'art. Y a-t-il un art pernicieux? Oui. C'est celui qui dérange les conditions de la vie. Le vice est séduisant, il faut le peindre séduisant; mais il traîne avec lui des maladies et des douleurs morales singulières. Il faut les décrire. Etudiez toutes les plaies comme un médecin qui fait, son service dans un hôpital, et l'école du bon sens, l'école exclusivement morale, ne trouvera p
- Commentez la citation de Théophile Gautier : « La poésie est un luxe nécessaire ».