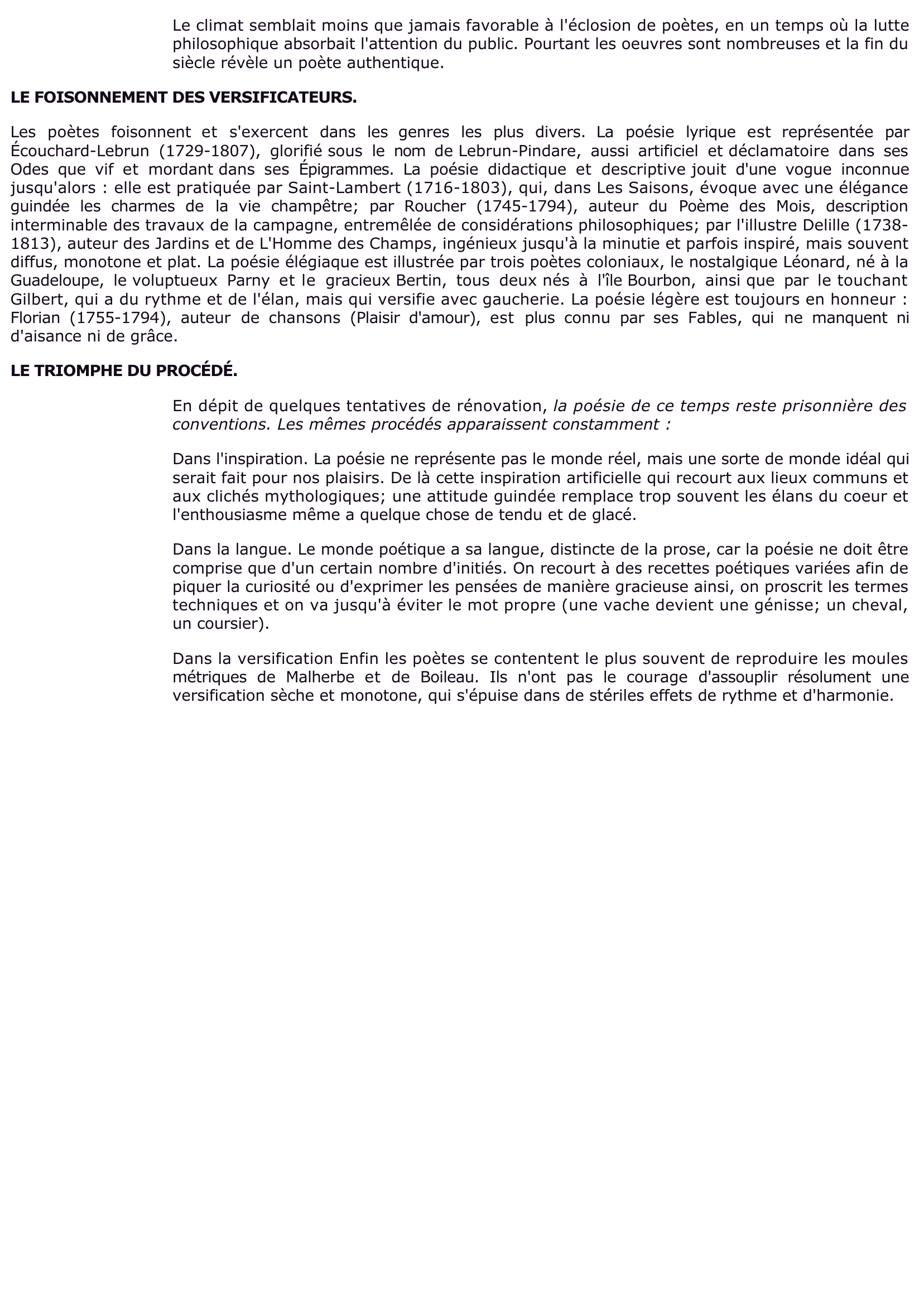Prédécesseurs et contemporains de Chénier
Extrait du document
«
Le climat semblait moins que jamais favorable à l'éclosion de poètes, en un temps où la lutte
philosophique absorbait l'attention du public.
Pourtant les oeuvres sont nombreuses et la fin du
siècle révèle un poète authentique.
LE FOISONNEMENT DES VERSIFICATEURS.
Les poètes foisonnent et s'exercent dans les genres les plus divers.
La poésie lyrique est représentée par
Écouchard-Lebrun (1729-1807), glorifié sous le nom de Lebrun-Pindare, aussi artificiel et déclamatoire dans ses
Odes que vif et mordant dans ses Épigrammes.
La poésie didactique et descriptive jouit d'une vogue inconnue
jusqu'alors : elle est pratiquée par Saint-Lambert (1716-1803), qui, dans Les Saisons, évoque avec une élégance
guindée les charmes de la vie champêtre; par Roucher (1745-1794), auteur du Poème des Mois, description
interminable des travaux de la campagne, entremêlée de considérations philosophiques; par l'illustre Delille (17381813), auteur des Jardins et de L'Homme des Champs, ingénieux jusqu'à la minutie et parfois inspiré, mais souvent
diffus, monotone et plat.
La poésie élégiaque est illustrée par trois poètes coloniaux, le nostalgique Léonard, né à la
Guadeloupe, le voluptueux Parny et le gracieux Bertin, tous deux nés à l'île Bourbon, ainsi que par le touchant
Gilbert, qui a du rythme et de l'élan, mais qui versifie avec gaucherie.
La poésie légère est toujours en honneur :
Florian (1755-1794), auteur de chansons (Plaisir d'amour), est plus connu par ses Fables, qui ne manquent ni
d'aisance ni de grâce.
LE TRIOMPHE DU PROCÉDÉ.
En dépit de quelques tentatives de rénovation, la poésie de ce temps reste prisonnière des
conventions.
Les mêmes procédés apparaissent constamment :
Dans l'inspiration.
La poésie ne représente pas le monde réel, mais une sorte de monde idéal qui
serait fait pour nos plaisirs.
De là cette inspiration artificielle qui recourt aux lieux communs et
aux clichés mythologiques; une attitude guindée remplace trop souvent les élans du coeur et
l'enthousiasme même a quelque chose de tendu et de glacé.
Dans la langue.
Le monde poétique a sa langue, distincte de la prose, car la poésie ne doit être
comprise que d'un certain nombre d'initiés.
On recourt à des recettes poétiques variées afin de
piquer la curiosité ou d'exprimer les pensées de manière gracieuse ainsi, on proscrit les termes
techniques et on va jusqu'à éviter le mot propre (une vache devient une génisse; un cheval,
un coursier).
Dans la versification Enfin les poètes se contentent le plus souvent de reproduire les moules
métriques de Malherbe et de Boileau.
Ils n'ont pas le courage d'assouplir résolument une
versification sèche et monotone, qui s'épuise dans de stériles effets de rythme et d'harmonie..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les contemplations) - A André Chénier
- André CHÉNIER (1762-1794) (Recueil : Elégies) - Versailles
- André CHÉNIER (1762-1794) (Recueil : Elégies) - Oh ! puisse le ciseau qui doit trancher mes jours
- André CHÉNIER (1762-1794) (Recueil : Poésies Antiques) - La jeune Tarentine
- André CHÉNIER (1762-1794) (Recueil : Poésies Antiques) - J'étais un faible enfant qu'elle était grande et belle