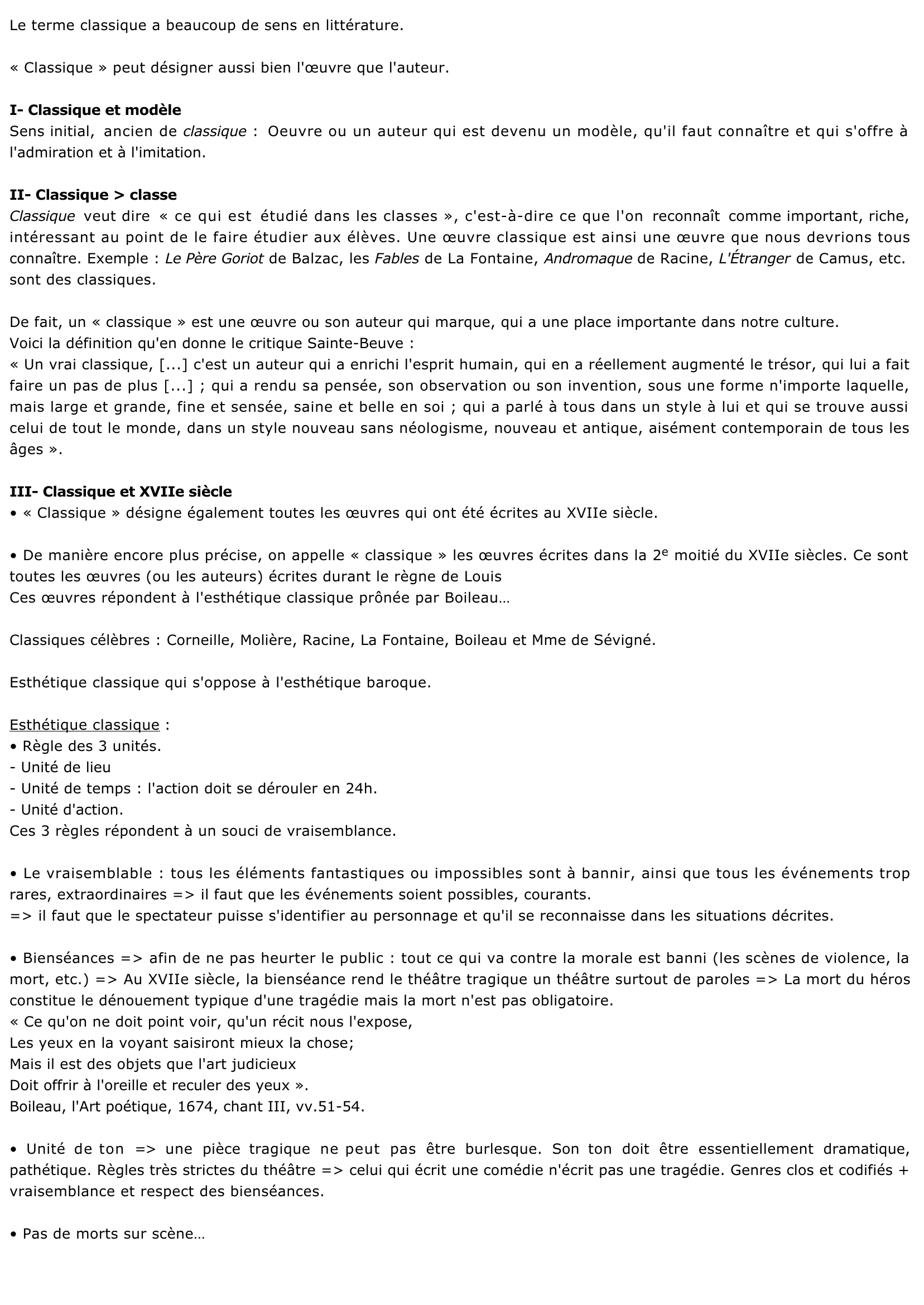Qu'est-ce qu'un classique ?
Extrait du document
«
Le terme classique a beaucoup de sens en littérature.
« Classique » peut désigner aussi bien l'œuvre que l'auteur.
I- Classique et modèle
Sens initial, ancien de classique : Oeuvre ou un auteur qui est devenu un modèle, qu'il faut connaître et qui s'offre à
l'admiration et à l'imitation.
II- Classique > classe
Classique veut dire « ce qui est étudié dans les classes », c'est-à-dire ce que l'on reconnaît comme important, riche,
intéressant au point de le faire étudier aux élèves.
Une œuvre classique est ainsi une œuvre que nous devrions tous
connaître.
Exemple : Le Père Goriot de Balzac, les Fables de La Fontaine, Andromaque de Racine, L'Étranger de Camus, etc.
sont des classiques.
De fait, un « classique » est une œuvre ou son auteur qui marque, qui a une place importante dans notre culture.
Voici la définition qu'en donne le critique Sainte-Beuve :
« Un vrai classique, [...] c'est un auteur qui a enrichi l'esprit humain, qui en a réellement augmenté le trésor, qui lui a fait
faire un pas de plus [...] ; qui a rendu sa pensée, son observation ou son invention, sous une forme n'importe laquelle,
mais large et grande, fine et sensée, saine et belle en soi ; qui a parlé à tous dans un style à lui et qui se trouve aussi
celui de tout le monde, dans un style nouveau sans néologisme, nouveau et antique, aisément contemporain de tous les
âges ».
III- Classique et XVIIe siècle
• « Classique » désigne également toutes les œuvres qui ont été écrites au XVIIe siècle.
• De manière encore plus précise, on appelle « classique » les œuvres écrites dans la 2e moitié du XVIIe siècles.
Ce sont
toutes les œuvres (ou les auteurs) écrites durant le règne de Louis
Ces œuvres répondent à l'esthétique classique prônée par Boileau…
Classiques célèbres : Corneille, Molière, Racine, La Fontaine, Boileau et Mme de Sévigné.
Esthétique classique qui s'oppose à l'esthétique baroque.
Esthétique classique :
• Règle des 3 unités.
- Unité de lieu
- Unité de temps : l'action doit se dérouler en 24h.
- Unité d'action.
Ces 3 règles répondent à un souci de vraisemblance.
• Le vraisemblable : tous les éléments fantastiques ou impossibles sont à bannir, ainsi que tous les événements trop
rares, extraordinaires => il faut que les événements soient possibles, courants.
=> il faut que le spectateur puisse s'identifier au personnage et qu'il se reconnaisse dans les situations décrites.
• Bienséances => afin de ne pas heurter le public : tout ce qui va contre la morale est banni (les scènes de violence, la
mort, etc.) => Au XVIIe siècle, la bienséance rend le théâtre tragique un théâtre surtout de paroles => La mort du héros
constitue le dénouement typique d'une tragédie mais la mort n'est pas obligatoire.
« Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose,
Les yeux en la voyant saisiront mieux la chose;
Mais il est des objets que l'art judicieux
Doit offrir à l'oreille et reculer des yeux ».
Boileau, l'Art poétique, 1674, chant III, vv.51-54.
• Unité de ton => une pièce tragique ne peut pas être burlesque.
Son ton doit être essentiellement dramatique,
pathétique.
Règles très strictes du théâtre => celui qui écrit une comédie n'écrit pas une tragédie.
Genres clos et codifiés +
vraisemblance et respect des bienséances.
• Pas de morts sur scène….
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'ART CLASSIQUE (Les arts plastiques)
- La doctrine classique.
- L'ESPRIT CLASSIQUE
- LE THÉÂTRE CLASSIQUE
- La tragédie classique et le théâtre moderne mélangent-ils les genres et les registres ?