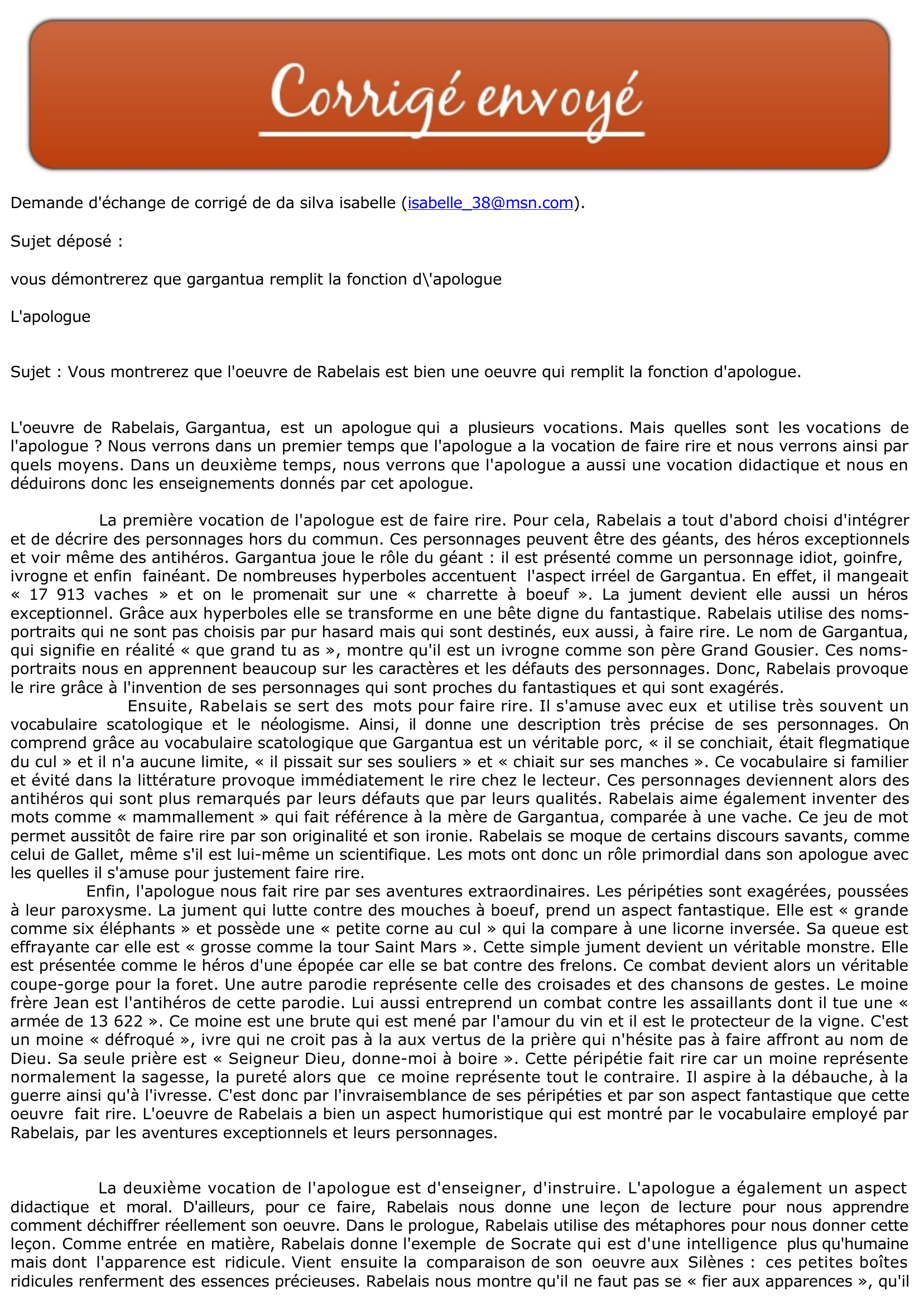Vous montrerez que l'oeuvre de Rabelais est bien une oeuvre qui remplit la fonction d'apologue.
Extrait du document
«
Demande d'échange de corrigé de da silva isabelle ([email protected]).
Sujet déposé :
vous démontrerez que gargantua remplit la fonction d\'apologue
L'apologue
Sujet : Vous montrerez que l'oeuvre de Rabelais est bien une oeuvre qui remplit la fonction d'apologue.
L'oeuvre de Rabelais, Gargantua, est un apologue qui a plusieurs vocations.
Mais quelles sont les vocations de
l'apologue ? Nous verrons dans un premier temps que l'apologue a la vocation de faire rire et nous verrons ainsi par
quels moyens.
Dans un deuxième temps, nous verrons que l'apologue a aussi une vocation didactique et nous en
déduirons donc les enseignements donnés par cet apologue.
La première vocation de l'apologue est de faire rire.
Pour cela, Rabelais a tout d'abord choisi d'intégrer
et de décrire des personnages hors du commun.
Ces personnages peuvent être des géants, des héros exceptionnels
et voir même des antihéros.
Gargantua joue le rôle du géant : il est présenté comme un personnage idiot, goinfre,
ivrogne et enfin fainéant.
De nombreuses hyperboles accentuent l'aspect irréel de Gargantua.
En effet, il mangeait
« 17 913 vaches » et on le promenait sur une « charrette à boeuf ».
La jument devient elle aussi un héros
exceptionnel.
Grâce aux hyperboles elle se transforme en une bête digne du fantastique.
Rabelais utilise des nomsportraits qui ne sont pas choisis par pur hasard mais qui sont destinés, eux aussi, à faire rire.
Le nom de Gargantua,
qui signifie en réalité « que grand tu as », montre qu'il est un ivrogne comme son père Grand Gousier.
Ces nomsportraits nous en apprennent beaucoup sur les caractères et les défauts des personnages.
Donc, Rabelais provoque
le rire grâce à l'invention de ses personnages qui sont proches du fantastiques et qui sont exagérés.
Ensuite, Rabelais se sert des mots pour faire rire.
Il s'amuse avec eux et utilise très souvent un
vocabulaire scatologique et le néologisme.
Ainsi, il donne une description très précise de ses personnages.
On
comprend grâce au vocabulaire scatologique que Gargantua est un véritable porc, « il se conchiait, était flegmatique
du cul » et il n'a aucune limite, « il pissait sur ses souliers » et « chiait sur ses manches ».
Ce vocabulaire si familier
et évité dans la littérature provoque immédiatement le rire chez le lecteur.
Ces personnages deviennent alors des
antihéros qui sont plus remarqués par leurs défauts que par leurs qualités.
Rabelais aime également inventer des
mots comme « mammallement » qui fait référence à la mère de Gargantua, comparée à une vache.
Ce jeu de mot
permet aussitôt de faire rire par son originalité et son ironie.
Rabelais se moque de certains discours savants, comme
celui de Gallet, même s'il est lui-même un scientifique.
Les mots ont donc un rôle primordial dans son apologue avec
les quelles il s'amuse pour justement faire rire.
Enfin, l'apologue nous fait rire par ses aventures extraordinaires.
Les péripéties sont exagérées, poussées
à leur paroxysme.
La jument qui lutte contre des mouches à boeuf, prend un aspect fantastique.
Elle est « grande
comme six éléphants » et possède une « petite corne au cul » qui la compare à une licorne inversée.
Sa queue est
effrayante car elle est « grosse comme la tour Saint Mars ».
Cette simple jument devient un véritable monstre.
Elle
est présentée comme le héros d'une épopée car elle se bat contre des frelons.
Ce combat devient alors un véritable
coupe-gorge pour la foret.
Une autre parodie représente celle des croisades et des chansons de gestes.
Le moine
frère Jean est l'antihéros de cette parodie.
Lui aussi entreprend un combat contre les assaillants dont il tue une «
armée de 13 622 ».
Ce moine est une brute qui est mené par l'amour du vin et il est le protecteur de la vigne.
C'est
un moine « défroqué », ivre qui ne croit pas à la aux vertus de la prière qui n'hésite pas à faire affront au nom de
Dieu.
Sa seule prière est « Seigneur Dieu, donne-moi à boire ».
Cette péripétie fait rire car un moine représente
normalement la sagesse, la pureté alors que ce moine représente tout le contraire.
Il aspire à la débauche, à la
guerre ainsi qu'à l'ivresse.
C'est donc par l'invraisemblance de ses péripéties et par son aspect fantastique que cette
oeuvre fait rire.
L'oeuvre de Rabelais a bien un aspect humoristique qui est montré par le vocabulaire employé par
Rabelais, par les aventures exceptionnels et leurs personnages.
La deuxième vocation de l'apologue est d'enseigner, d'instruire.
L'apologue a également un aspect
didactique et moral.
D'ailleurs, pour ce faire, Rabelais nous donne une leçon de lecture pour nous apprendre
comment déchiffrer réellement son oeuvre.
Dans le prologue, Rabelais utilise des métaphores pour nous donner cette
leçon.
Comme entrée en matière, Rabelais donne l'exemple de Socrate qui est d'une intelligence plus qu'humaine
mais dont l'apparence est ridicule.
Vient ensuite la comparaison de son oeuvre aux Silènes : ces petites boîtes
ridicules renferment des essences précieuses.
Rabelais nous montre qu'il ne faut pas se « fier aux apparences », qu'il.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Je veux qu'un conte soit fondé sur la vraisemblance, et qu'il ne ressemble pas toujours à un rêve. Je désire qu'il n'ait rien de trivial ni d'extravagant. Je voudrais surtout que, sous le voile de la fable, il laissât entrevoir aux yeux exercés quelque vérité fine qui échappe au vulgaire. » - Vous montrerez que Candide souligné de Voltaire rempli la fonction d'apologue tel que lui-même la définit dans son conte Le Taureau Blanc.
- En janvier 1976, lors de la parution de son roman, La Valse aux adieux, l'écrivain tchèque Milan Kundera déclarait : « Dans la vie, l'homme est continuellement coupé de son propre passé et de celui de l'humanité. Le roman permet de soigner cette blessure. » L'opinion de Kundera sur la fonction de l'oeuvre romanesque rejoint-elle votre expérience personnelle de lecteur ?
- « L'idée même que la signification d'une oeuvre valable puisse être épuisée après deux ou trois lectures est une idée frivole. Pire que frivole : c'est une idée paresseuse », écrivait Claude-Edmonde Magny en 1950 dans Histoire du roman français depuis 1918. En vous appuyant sur des exemples précis que vous emprunterez à la littérature et, éventuellement, à d'autres formes artistiques, vous montrerez pourquoi certains aspects essentiels d'une oeuvre ne se livrent que peu à peu et commen
- Après avoir parlé du théâtre de Samuel Beckett, Gaétan Picon déclare à propos des pièces d'Ionesco qu'on assiste à notre époque à une « mise en question de la convention théâtrale ». En vous appuyant sur l'oeuvre d'un des écrivains que l'on a rangés parmi les créateurs d'un «anti-théâtre » vous montrerez comment elle s'oppose sur le plan des structures dramatiques et sur celui de la conception du comique au théâtre traditionnel.
- L'idée même que la signification d'une oeuvre valable puisse être épuisée après deux ou trois lectures est une idée frivole. Pire que frivole : c'est une idée paresseuse », écrivait Claude-Edmonde Magny en 1950 dans Histoire du roman français depuis 1918. En vous appuyant sur des exemples précis que vous emprunterez à la littérature et, éventuellement, à d'autres formes artistiques, vous montrerez pourquoi certains aspects essentiels d'une oeuvre ne se livrent que peu à peu et comment