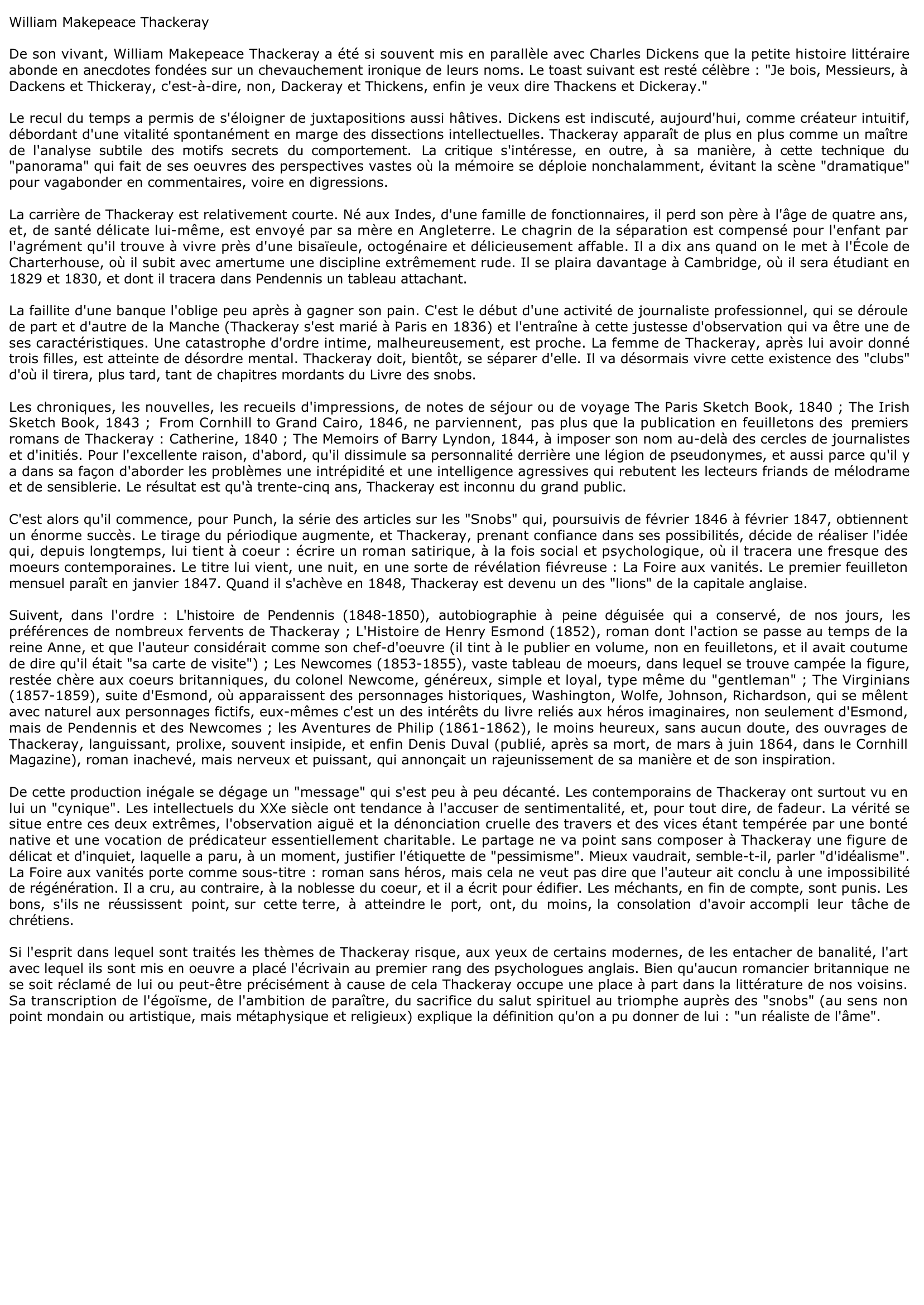William Makepeace Thackeray
Extrait du document
«
William Makepeace Thackeray
De son vivant, William Makepeace Thackeray a été si souvent mis en parallèle avec Charles Dickens que la petite histoire littéraire
abonde en anecdotes fondées sur un chevauchement ironique de leurs noms.
Le toast suivant est resté célèbre : "Je bois, Messieurs, à
Dackens et Thickeray, c'est-à-dire, non, Dackeray et Thickens, enfin je veux dire Thackens et Dickeray."
Le recul du temps a permis de s'éloigner de juxtapositions aussi hâtives.
Dickens est indiscuté, aujourd'hui, comme créateur intuitif,
débordant d'une vitalité spontanément en marge des dissections intellectuelles.
Thackeray apparaît de plus en plus comme un maître
de l'analyse subtile des motifs secrets du comportement.
La critique s'intéresse, en outre, à sa manière, à cette technique du
"panorama" qui fait de ses oeuvres des perspectives vastes où la mémoire se déploie nonchalamment, évitant la scène "dramatique"
pour vagabonder en commentaires, voire en digressions.
La carrière de Thackeray est relativement courte.
Né aux Indes, d'une famille de fonctionnaires, il perd son père à l'âge de quatre ans,
et, de santé délicate lui-même, est envoyé par sa mère en Angleterre.
Le chagrin de la séparation est compensé pour l'enfant par
l'agrément qu'il trouve à vivre près d'une bisaïeule, octogénaire et délicieusement affable.
Il a dix ans quand on le met à l'École de
Charterhouse, où il subit avec amertume une discipline extrêmement rude.
Il se plaira davantage à Cambridge, où il sera étudiant en
1829 et 1830, et dont il tracera dans Pendennis un tableau attachant.
La faillite d'une banque l'oblige peu après à gagner son pain.
C'est le début d'une activité de journaliste professionnel, qui se déroule
de part et d'autre de la Manche (Thackeray s'est marié à Paris en 1836) et l'entraîne à cette justesse d'observation qui va être une de
ses caractéristiques.
Une catastrophe d'ordre intime, malheureusement, est proche.
La femme de Thackeray, après lui avoir donné
trois filles, est atteinte de désordre mental.
Thackeray doit, bientôt, se séparer d'elle.
Il va désormais vivre cette existence des "clubs"
d'où il tirera, plus tard, tant de chapitres mordants du Livre des snobs.
Les chroniques, les nouvelles, les recueils d'impressions, de notes de séjour ou de voyage The Paris Sketch Book, 1840 ; The Irish
Sketch Book, 1843 ; From Cornhill to Grand Cairo, 1846, ne parviennent, pas plus que la publication en feuilletons des premiers
romans de Thackeray : Catherine, 1840 ; The Memoirs of Barry Lyndon, 1844, à imposer son nom au-delà des cercles de journalistes
et d'initiés.
Pour l'excellente raison, d'abord, qu'il dissimule sa personnalité derrière une légion de pseudonymes, et aussi parce qu'il y
a dans sa façon d'aborder les problèmes une intrépidité et une intelligence agressives qui rebutent les lecteurs friands de mélodrame
et de sensiblerie.
Le résultat est qu'à trente-cinq ans, Thackeray est inconnu du grand public.
C'est alors qu'il commence, pour Punch, la série des articles sur les "Snobs" qui, poursuivis de février 1846 à février 1847, obtiennent
un énorme succès.
Le tirage du périodique augmente, et Thackeray, prenant confiance dans ses possibilités, décide de réaliser l'idée
qui, depuis longtemps, lui tient à coeur : écrire un roman satirique, à la fois social et psychologique, où il tracera une fresque des
moeurs contemporaines.
Le titre lui vient, une nuit, en une sorte de révélation fiévreuse : La Foire aux vanités.
Le premier feuilleton
mensuel paraît en janvier 1847.
Quand il s'achève en 1848, Thackeray est devenu un des "lions" de la capitale anglaise.
Suivent, dans l'ordre : L'histoire de Pendennis (1848-1850), autobiographie à peine déguisée qui a conservé, de nos jours, les
préférences de nombreux fervents de Thackeray ; L'Histoire de Henry Esmond (1852), roman dont l'action se passe au temps de la
reine Anne, et que l'auteur considérait comme son chef-d'oeuvre (il tint à le publier en volume, non en feuilletons, et il avait coutume
de dire qu'il était "sa carte de visite") ; Les Newcomes (1853-1855), vaste tableau de moeurs, dans lequel se trouve campée la figure,
restée chère aux coeurs britanniques, du colonel Newcome, généreux, simple et loyal, type même du "gentleman" ; The Virginians
(1857-1859), suite d'Esmond, où apparaissent des personnages historiques, Washington, Wolfe, Johnson, Richardson, qui se mêlent
avec naturel aux personnages fictifs, eux-mêmes c'est un des intérêts du livre reliés aux héros imaginaires, non seulement d'Esmond,
mais de Pendennis et des Newcomes ; les Aventures de Philip (1861-1862), le moins heureux, sans aucun doute, des ouvrages de
Thackeray, languissant, prolixe, souvent insipide, et enfin Denis Duval (publié, après sa mort, de mars à juin 1864, dans le Cornhill
Magazine), roman inachevé, mais nerveux et puissant, qui annonçait un rajeunissement de sa manière et de son inspiration.
De cette production inégale se dégage un "message" qui s'est peu à peu décanté.
Les contemporains de Thackeray ont surtout vu en
lui un "cynique".
Les intellectuels du XXe siècle ont tendance à l'accuser de sentimentalité, et, pour tout dire, de fadeur.
La vérité se
situe entre ces deux extrêmes, l'observation aiguë et la dénonciation cruelle des travers et des vices étant tempérée par une bonté
native et une vocation de prédicateur essentiellement charitable.
Le partage ne va point sans composer à Thackeray une figure de
délicat et d'inquiet, laquelle a paru, à un moment, justifier l'étiquette de "pessimisme".
Mieux vaudrait, semble-t-il, parler "d'idéalisme".
La Foire aux vanités porte comme sous-titre : roman sans héros, mais cela ne veut pas dire que l'auteur ait conclu à une impossibilité
de régénération.
Il a cru, au contraire, à la noblesse du coeur, et il a écrit pour édifier.
Les méchants, en fin de compte, sont punis.
Les
bons, s'ils ne réussissent point, sur cette terre, à atteindre le port, ont, du moins, la consolation d'avoir accompli leur tâche de
chrétiens.
Si l'esprit dans lequel sont traités les thèmes de Thackeray risque, aux yeux de certains modernes, de les entacher de banalité, l'art
avec lequel ils sont mis en oeuvre a placé l'écrivain au premier rang des psychologues anglais.
Bien qu'aucun romancier britannique ne
se soit réclamé de lui ou peut-être précisément à cause de cela Thackeray occupe une place à part dans la littérature de nos voisins.
Sa transcription de l'égoïsme, de l'ambition de paraître, du sacrifice du salut spirituel au triomphe auprès des "snobs" (au sens non
point mondain ou artistique, mais métaphysique et religieux) explique la définition qu'on a pu donner de lui : "un réaliste de l'âme"..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- William Styron
- William Shakespeare
- William Faulkner
- William Wordsworth
- William CHAPMAN (1850-1917) - Notre Langue