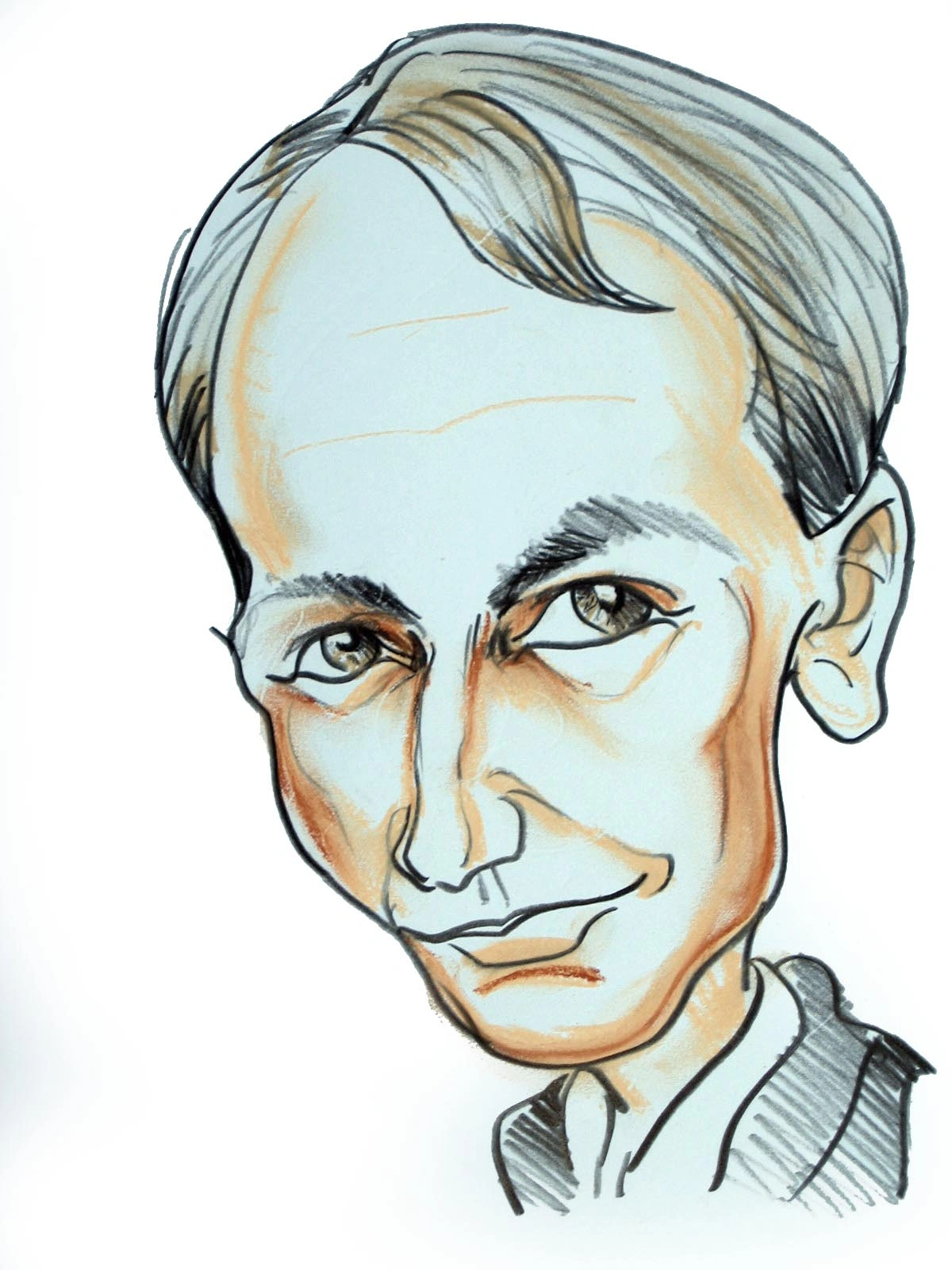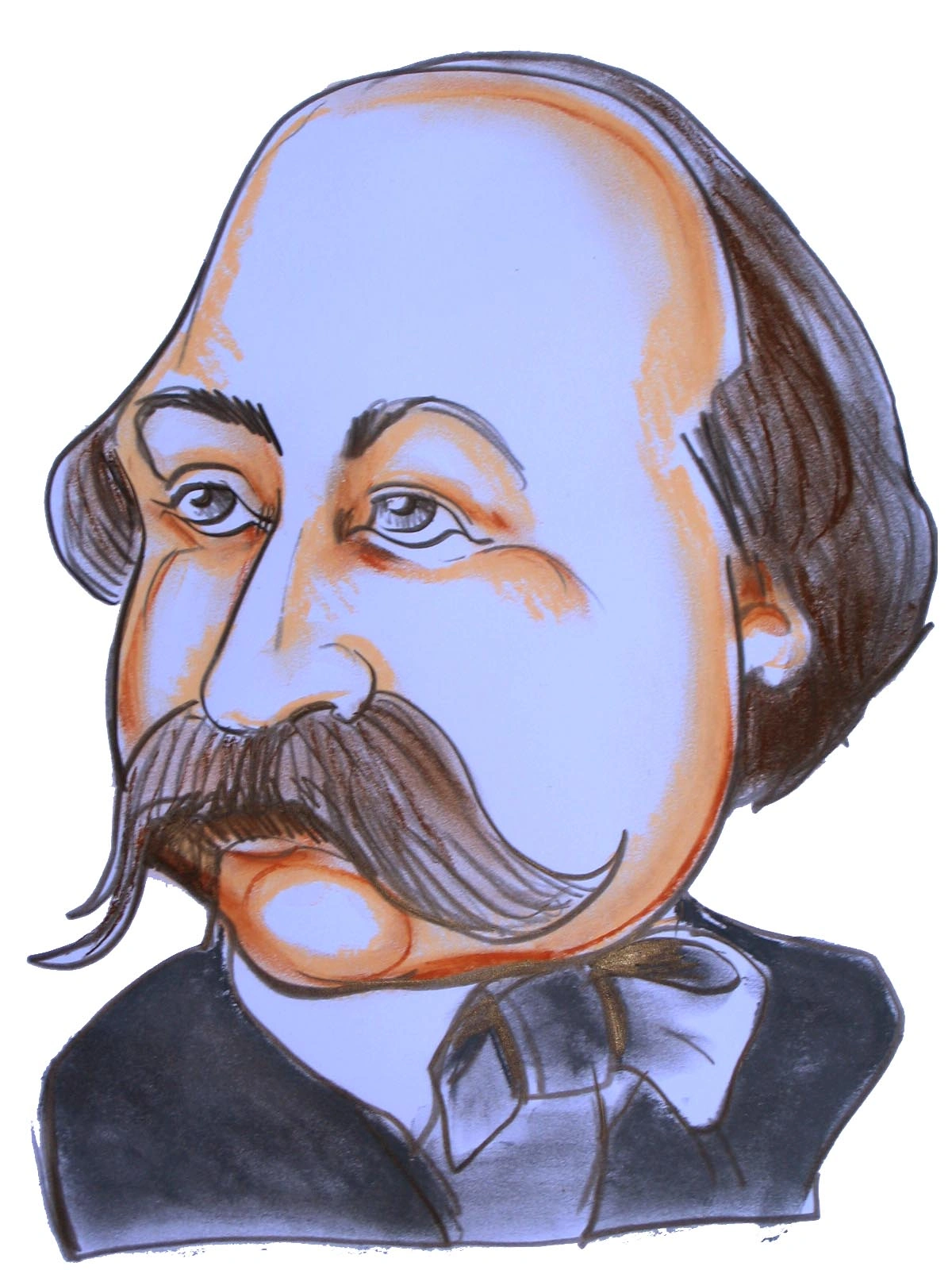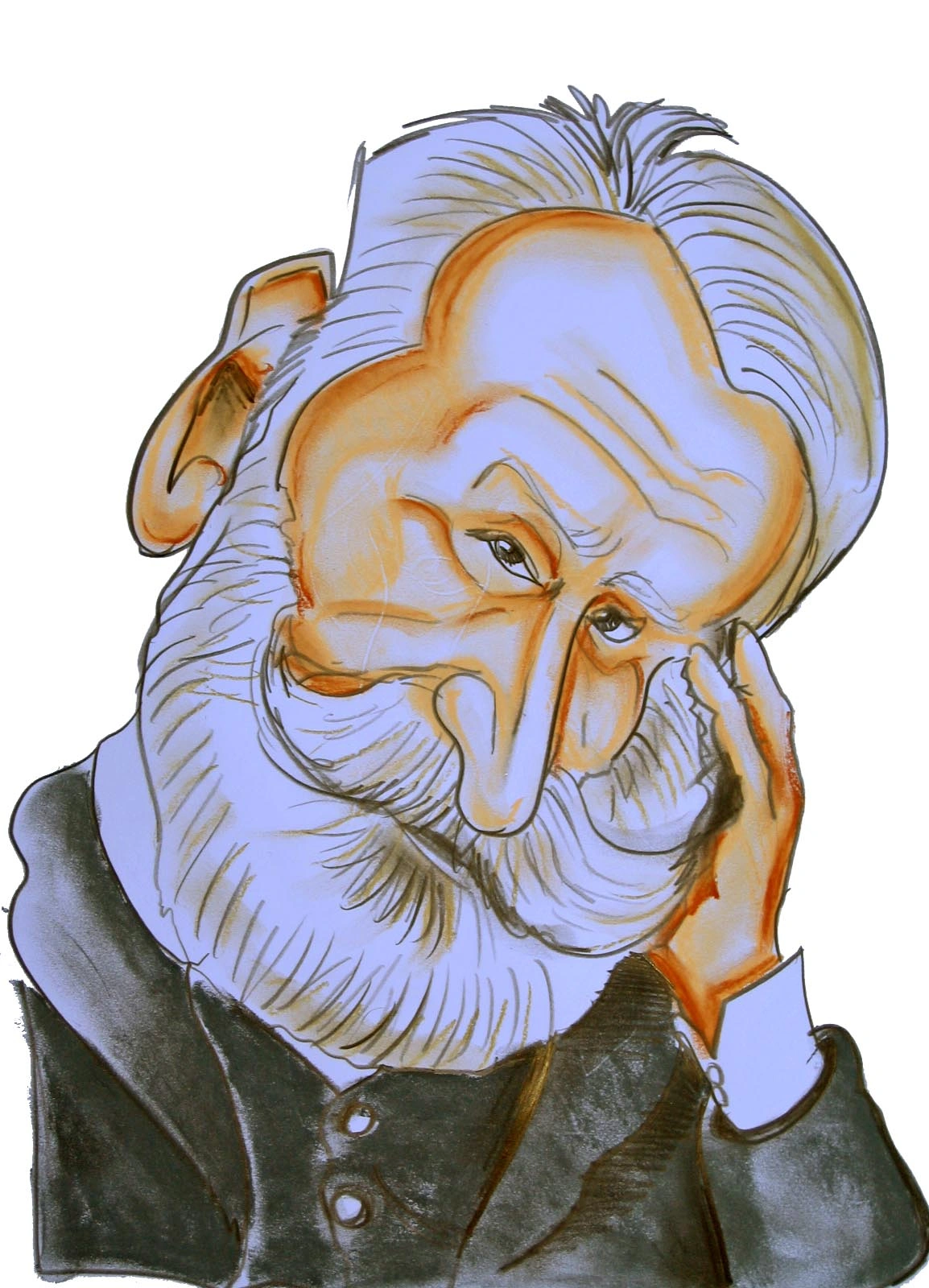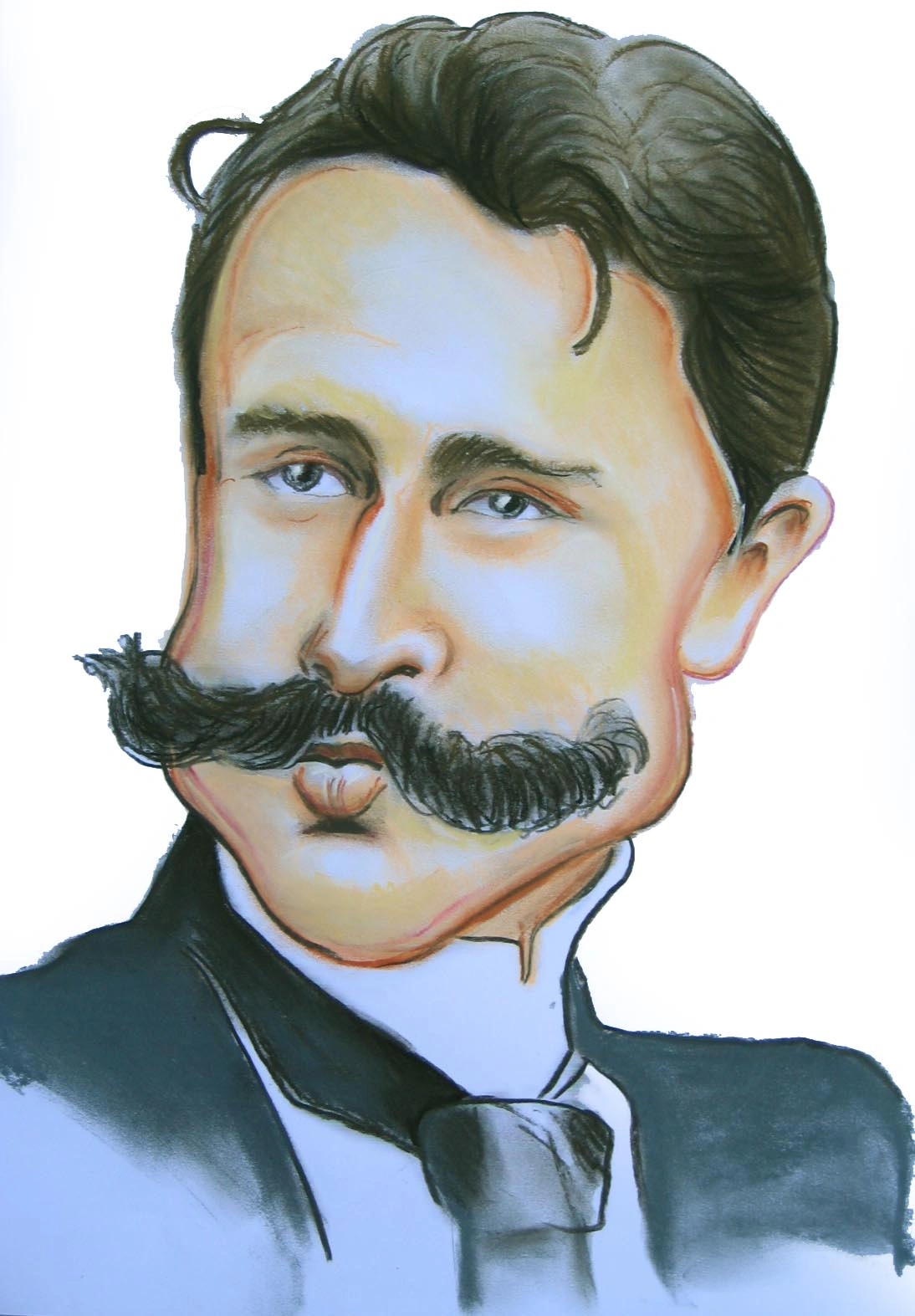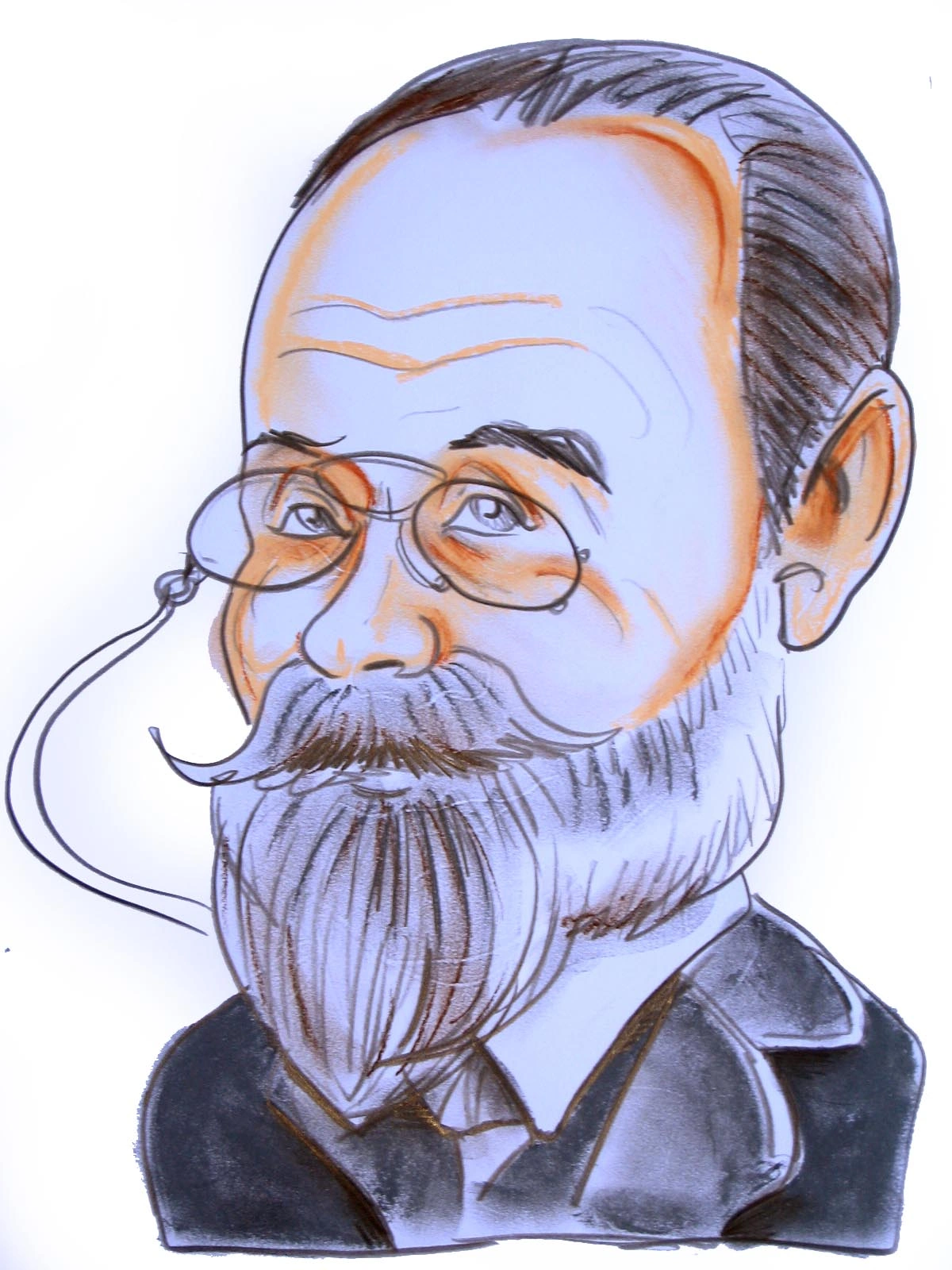100 résultats pour "parlement"
-
On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nos, leur crie-t-on. Hélas ! Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! Insensé qui crois que je ne suis pas toi ! (Victor HUGO). qu'en pensez-vous ?
Le lyrisme est absent de la poésie du XVIIe siècle. Pour Malherbe lui-même les thèmes lyriques ne sont que des lieux communs qu'il développe à la façon d'un orateur : Stances à Du Perrier. C'est seulement au XIXe siècle, avec le Romantisme et sous l'influence de Jean-Jacques et de Chateaubriand, que la poésie deviendra vraiment l'âme qui se révèle et se répand. Ce n'a pas été sans protestation et le Parnasse sera une réaction contre la poésie personnelle (sonnet de Leconte de Lisle : les Montreu...
- Pourquoi et comment parler de soi ?
-
Dans la préface de son recueil de poèmes Les Contemplations (1856), Victor Hugo répond à ceux qui se plaignent des écrivains qui disent moi : « Ah ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé qui crois que je ne suis pas toi ! ?
LE ROMANTISME Hugo écrit dans une de ses préfaces : « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas P Ah ! insensé qui 1t:rois que je ne suis pas toi. » En appliquant ce jugement à l'ensemble de nos poètes roman~ tiques, vous montrerez que les sentiments qu'ils expriment, les grands problèmes qu'il évoquent, ont une portée largement humaine. (Rennes) LES GRANDES LIGNES DU PLAN Comme il arrive souvent, la citation n'est qu'un point de départ. Les indications pr...
-
VOLTAIRE, parlant des grands écrivains du siècle de Louis XIV, écrit : La route était difficile au commencement du siècle parce que personne n'y avait marché : elle l'est aujourd'hui parce qu'elle a été battue. Les grands hommes du siècle passé ont enseigné à penser et à parler : ils ont dit ce qu'on ne savait pas. Ceux qui leur succèdent ne peuvent guère dire que ce qu'on sait. Dans quelle mesure, à votre avis, l'oeuvre même de VOLTAIRE justifie-t-elle cette constatation pessimiste ?
VOLTAIRE, parlant des grands écrivains du siècle de Louis XIV, écrit : La route était difficile au commencement du siècle parce que personne n\'y avait marché : elle l\'est aujourd'hui parce qu\'elle a été battue. Les grands hommes du siècle passé ont enseigné à penser et à parler : ils ont dit ce qu'on ne savait pas. Ceux qui leur succèdent ne peuvent guère dire que ce qu'on sait. Dans quelle mesure, à votre avis, l\'oeuvre même de VOLTAIRE justifie-t-elle cette constatation pessimiste ? A. Com...
-
Hugo a écrit: Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! Insensé qui crois que je ne suis pas toi. Qu'en pensez-vous ?
Hugo a écrit: « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! Insensé qui crois que je ne suis pas toi. » Qu'en pensez-vous ? Analyse du sujet et problématisation : Hugo évoque, dans cette phrase des Contemplations, la portée universelle d'une littérature personnelle. Il établit une équivalence entre le « moi » de l'auteur et celui du lecteur( donc de tous les lecteurs potentiels) qui semblent entrer en communion lors de la lecture. Le lecteur refusant...
-
Il paraît qu'il est immoral de parler de soi. Moi je ne sais guère que parler de moi. Le moi n'est pas du tout haïssable, bien au contraire, écrit Paul Léautaud dans son Journal. Qu'en pensez-vous ?
Blaise Pascal dans une formule célèbre des Pensées proclame que « le moi est haïssable ». Il s'en explique au nom de valeurs morales : « En un mot, le moi a deux qualités : il est injuste en soi, en ce qu'il se fait centre de tout ; il est incommode aux autres, en ce qu'il les veut asservir : car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres ! » (VII, 455). C'est pourquoi Pascal condamne les Essais de Montaigne : « Le sot projet qu'il a de se peindre ! » (II, 62). Trois si...
-
« Nous autres, écrivains du xxe siècle, ne serons plus jamais seuls. Nous devons savoir au contraire que nous ne pouvons nous évader de la misère commune, et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler, dans la mesure de nos moyens, pour ceux qui ne peuvent le faire... Il n'y a pas pour l'artiste de bourreaux privilégiés... » A. CAMUS, Discours de Suède. La littérature a-t-elle attendu le XXe siècle pour lutter contre les bourreaux ? Vous avez lu des textes qui prouve
« Nous autres, écrivains du XXe siècle, ne serons plus jamais seuls. Nous devons savoir au contraire que nous ne pouvons nous évader de la misère commune, et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler, dans la mesure de nos moyens, pour ceux qui ne peuvent le faire... Il n'y a pas pour l'artiste de bourreaux privilégiés... » A. CAMUS, Discours de Suède. La littérature a-t-elle attendu le XXe siècle pour lutter contre les bourreaux ? Vous avez lu des textes qui prouvent le cont...
-
« Nous autres, écrivains du XXe siècle, ne serons plus jamais seuls. Nous devons savoir au contraire que nous ne pouvons nous évader de la misère commune, et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler, dans la mesure de nos moyens, pour ceux qui ne peuvent le faire... Il n'y a pas pour l'artiste de bourreaux privilégiés... » A. Camus, Discours de Suède. La littérature a-t-elle attendu le XXe siècle pour lutter contre les bourreaux? Vous avez lu des textes qui prouven
« Nous autres, écrivains du XXe siècle, ne serons plus jamais seuls. Nous devons savoir au contraire que nous ne pouvons nous évader de la misère commune, et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler, dans la mesure de nos moyens, pour ceux qui ne peuvent le faire... Il n'y a pas pour l'artiste de bourreaux privilégiés... » A. Camus, Discours de Suède. La littérature a-t-elle attendu le XXe siècle pour lutter contre les bourreaux? Vous avez lu des textes qui prouvent le contr...
-
-
Dans la pièce de Ionesco, Rhinocéros, en quoi peut-on parler de faillite du langage ?
Analyse du sujet et problématisation : Ionesco publie la pièce Rhinocéros en 1959, pièce emblématique du « théâtre de l'absurde » dépeignant une épidémie imaginaire de "rhinocérite", maladie qui effraie tous les habitants d'une ville et les transforme bientôt tous en rhinocéros. L'expression faillite du langage évoque l'échec de la fonction propre au langage qui est essentiellement une fonction de communication. Le langage est la faculté d'expression que possède l'homme, faculté qui lui permet d...
-
Le romantisme a été la grande révolution littéraire moderne. On a parlé souvent de réactions contre le romantisme. On a donné ce nom à des mouvements comme le Parnasse, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, le néo-classicisme. Mais il ne serait pas difficile de montrer qu'ils sont bien plutôt des décompositions ou des transformations du romantisme. Commentez ce jugement ?
Introduction. Une vue classique des manuels consiste à montrer le romantisme envahissant la scène littéraire dans les années 1815 à 1830, disparaissant comme école, mais se continuant comme tendance jusqu'en 1843, date de l'échec des Burgraves. Le grand succès de Lucrèce, tragédie « classique » de Ponsard, en 1843, les débuts de Leconte de Lisle vers 1845 semblent amorcer une réaction qui ne s'interrompra plus jusqu'à nos jours. Traiter une œuvre de romantique sera dorénavant une qualification p...
- Pierre CORNEILLE (1606-1684) - Que la vérité parle au dedans du coeur
- Autobiographie : est-ce seulement parler de soi ?
- Nérée BEAUCHEMIN (1850-1931) (Recueil : Patrie intime) - Le vieux parler
- Faut-il parler et écrire seulement pour instruire ?
-
« Je hais les livres; ils n'apprennent qu'à parler de ce qu'on ne sait pas ». Jean Jacques Rousseau, L'Emile.
Définition des termes du sujet Il s'agit ici d'expliquer et critiquer le point d e vue d e Rousseau selon lequel les livres seraient haïssables, en interrogeant la raison pour laquelle il déclare cela : « ils n'apprennent qu'à parler de ce qu'on ne sait pas ». Il faut d'abord s'interroger sur le contexte de cette déclaration : celle-ci prend en effet place dans un traité sur l'éducation, et c'est donc en particulier la valeur pédagogique et formatrice des livres qui est en jeu (et notamment dans...
-
Préférez-vous les oeuvres littéraires dans lesquelles l'auteur parle ouvertement de lui-même ou celles dans lesquelles il s'efface ?
Le sujet pose vraisemblablement le problème de notre regard sur l'œuvre et de notre sensibilité à son égard. De plus, il convient de savoir que la question de la place à faire à l'auteur (donc de ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire) est l'une des plus controversées dans les études littéraires. En conséquence il s'avère délicat de se prononcer sur le rôle que celui-ci doit tenir dans son oeuvre. De ce fait, nous pouvons choisir de poser le problème en ces termes : Quels sont les différents m...
-
-
Préférez-vous les oeuvres littéraires dans lesquelles l'auteur parle ouvertement de lui-même ou celles dans lesquelles il s'efface ? Justifiez votre préférence par des exemples précis ?
Le sujet pose vraisemblablement le problème de notre regard sur l'œuvre et de notre sensibilité à son égard. De plus, il convient de savoir que la question de la place à faire à l'auteur (donc de ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire) est l'une des plus controversées dans les études littéraires. En conséquence il s'avère délicat de se prononcer sur le rôle que celui-ci doit tenir dans son oeuvre. De ce fait, nous pouvons choisir de poser le problème en ces termes : Quels sont les différents m...
- Rainer Maria RILKE (1875-1926) (Recueil : Les quatrains valaisans) - Comme tel qui parle de sa mère
-
Après avoir parlé du théâtre de Samuel Beckett, Gaétan Picon déclare à propos des pièces d'Ionesco qu'on assiste à notre époque à une « mise en question de la convention théâtrale ». En vous appuyant sur l'oeuvre d'un des écrivains que l'on a rangés parmi les créateurs d'un «anti-théâtre » vous montrerez comment elle s'oppose sur le plan des structures dramatiques et sur celui de la conception du comique au théâtre traditionnel.
Après avoir parlé du théâtre de Samuel Beckett, Gaétan Picon déclare à propos des pièces d\'Ionesco qu\'on assiste à notre époque à une « mise en question de la convention théâtrale ». En vous appuyant sur l\'oeuvre d\'un des écrivains que l\'on a rangés parmi les créateurs d\'un «anti-théâtre » vous montrerez comment elle s\'oppose sur le plan des structures dramatiques et sur celui de la conception du comique au théâtre traditionnel. INTRODUCTION L'étiquette commune sous laquelle on a rangé un...
- Joachim DU BELLAY (1522-1560) (Recueil : Les Regrets) - Cousin, parle toujours des vices en commun
- Paul VERLAINE (1844-1896) (Recueil : La bonne chanson) - Hier, on parlait de choses et d'autres
-
façons de parler
“Façons de parler” Amorce : Cyrano, de Gaulle en passant Demosthene et Cicérones, tous sont restés célèbres pour leur façon de maîtriser la langue afin de conquérir leur auditoire. En effet Bien qu’on parle souvent d’une seule langue uniforme par exemple le fr, il existe en fait 1000 façons de parler une seule et meme langue. Lorsqu’on pense aux façons de parler, on pense d’abord à l’expression habituellement utilisée pour designer une parole qui ne doit pas etre prise au pied de la lettre...
- Victor HUGO (1802-1885) - On vit, on parle...
- Jean MORÉAS (1856-1910) (Recueil : Les Stances) - Je viens de mal parler de toi ...
-
- Sabine SICAUD (1913-1928) (Recueil : Douleur, je vous déteste) - Vous parler ?
- Jean BOUCHET (1476-1557) - Quand j'ois parler d'un prince et de sa cour
- Odilon-Jean PÉRIER (1901-1928) (Recueil : Le promeneur) - Comme parle et se tait une fille des hommes
- Charles VION D'ALIBRAY (1600-1653) (Recueil : Vers moraux) - Tirsis, laisse parler le vulgaire insensé
- Marc de PAPILLON DE LASPHRISE (1555-1599) (Recueil : Les Amours de Théophile) - J'aime tant ce parler bégayement mignard
-
Tout ce que je vois jette les semences d'une révolution qui arrivera immanquablement, et dont je n'ai rai pas le plaisir d'être le témoin... Vous essaierez d'expliquer pourquoi Voltaire parlait ainsi et ce qu'il voulait dire ?
50. VOLTAIRE ' Tout ce que je vois jette les semences d'une révolution qui arrivera immanquablement, et dont je n'aurai pas le !Jlaisir d'être le témoin .... La lumière s'est tellement répandue de proche en proche, qu'on éclatera, à la première occasion;· et alors ce sera un beau tapage. Les jeunes gens sont bien heureux; ils verront de belles choses. • (Voltaire à Chauvelin, 2 avril 1764.) Vous essaierez d'expliquer pourquoi Voltaire parlait ainsi à ce qu'il çoulait dire. Quelles ' belles chose...
- Etienne de LA BOETIE (1530-1563) (Recueil : Vers françois) - Quand celle j'oy parler qui pare nostre France
- Pierre de RONSARD (1524-1585) (Recueil : Premier livre des Amours) - Ô doux parler, dont l'appât doucereux
-
- Dans quelle mesure peut-on parler d'un travail de l'écrivain ?
- Le théâtre peut-il parler d'un sujet aussi important que la guerre ?
- Je hais les livres; ils n'apprennent qu'à parler de ce qu'on ne sait pas, écrit Jean Jacques Rousseau dans son essai sur l'éducation, Emile. Vous discuterez ce point de vue.
-
« qu'est-ce que l'acanthe grecque ? Un artichaut stylisé. Stylisé, c'est-à-dire humanisé : tel que l'homme l'eût fait s'il eût été Dieu. l'homme sait que le monde n'est pas à l'échelle humaine ; et il voudrait qu'il le lût. Et lorsqu'il le reconstruit, c'est à cette échelle qu'il le reconstruit... Dans ce qu'il a d'essentiel, notre art est une humanisation du monde. » c'est ainsi qu'André Malraux, dans Les Noyers de l'Altenburg, lait parler, au colloque international de l'Altenburg, le
S~jets traités « Qu'est-tc que l'acant he gn:cque '? 11 artichaut stylisé. Stylisé, c'est-à-dire humanisé : tel CJUC l'homme l'eîll htit s'il etît été Dieu. L'homme sait que le monde n'est pas à l'échelle humaine ; et il Yondrait qu'il le fîu. Et lorsqu'il le n:construit. c'est à celle échelle qu'il le reconMruit... Dans ce qu'il a d'essentiel. notre art est une humanisation du monde. >> C'est aitL~i qu'Amlré MalratLx, dan Les },~l'I'I "S de I'Ailmburg, fait parler, a11 colloque intematicmal...
- Commentez cette affirmation : on ne doit parler, on ne doit écrire que pour instruire ?
- Discutez ce propos : on ne doit parler, on ne doit écrire que pour instruire ?
- Dans quelle mesure peut-on parler d'engagement humaniste au 16e siècle ?
- Peut-on parler d'un imaginaire social dans le Don Quichotte de CERVANTES ?
-
- Peut-on parler de comique dans l'oeuvre Le procés de Franz Kafka ?
-
Samuel Beckett, Oh ! les beaux jours (1963)
Demande d'échange de corrigé de Smith Elodie (margotte321@yahoo.fr). Sujet déposé :Commentaire de \"Oh Les Beaux Jours\" de Beckett Oh les Beaux Jours est une pièce a deux personnages, si on peut considere Willie comme un personnage, qui emmetera quelques grognements durant la piece. Elle fait partie de la fameuse trilogie de théâtre de l'absurde de Beckett avec En Attendant Godot et Fin de Partie. Beckett illustre a travers ces oueuvres la condition humaine qui sera confronte a différent problè...
- « L'artiste est celui qui laisse parler l'enfant au fond de lui ». Qu'en pensez-vous ?
- Jean de LINGENDES (1580-1616) - Alcidon parle
-
Pourquoi écrire et pour qui ?
Pourquoi écrire et pour qui ? I. Pour exprimer son moi et la condition humaine. Montaigne : « Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre » mais « chaque homme porte la forme de l'humaine condition. » (Essais). Lamartine : « Ce n'était pas un art, c'était le soulagement de mon coeur. » (A propos des Méditations). Chateaubriand : « On ne peint bien que son propre coeur en l'attribuant à un autre, et la meilleure partie du génie se compose de souvenirs. » F. Mauriac : « Écrire, c'est...
-
Jean Joinville
Jean Joinville Jean de Job, de Champagne, vassal du comte Thibault qui était aussi roi de Navarre, avait environ vingt-quatre ans quand, au moins d'août 1248, il s'embarqua à Marseille, avec le roi Louis IX et la fleur de la noblesse française, pour entreprendre la septième croisade, pieuse aventure qui finit assez mal, après avoir retenu Joinville six années hors de France. Le sénéchal était octogénaire quand, en 1305, la reine Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel et fille de son suzera...
- Pourquoi la lettre est-elle un moyen privilégié de connaître la personnalité de quelqu'un ? En quoi est-elle plus « parlante » qu'un portrait dressé par un tiers ?
- L'apparition du poème en prose a soulevé beaucoup de réticences, certains ont meme parlé à son sujet d'aveu d'impuissance. Que pensez vous de ce point de vue ?
-
- François VILLON (1431-x) (Recueil : Poésies diverses) - Louange à la Cour ou requête à la Cour de Parlement
- Un(e) artiste est invité(e) par un animateur de radio ou de télévision pour évoquer sa vie privée. Cet(te) artiste lui écrit une lettre pour expliquer pourquoi il (elle) accepte ou refuse de parler de lui-même (d'elle-même). Vous rédigerez cette lettre ?